Mots-clés : Emploi, Politique de l’emploi, Qualité du travail.
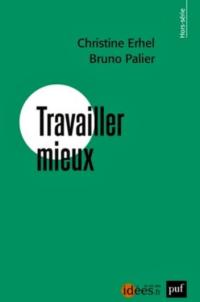
Résumé
Il s’agit dans ce livre de rassembler des perspectives sur les voies d’amélioration du travail à différents niveaux : la qualité des conditions de travail, du management, de l’organisation du travail, des droits d’expression des salariés ; le degré de maîtrise de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle, ou encore de l’écologisation du travail. L’ensemble se conçoit comme un engagement en faveur d’un travail soutenable pour les salariés comme pour les chefs d’entreprise.
L’ouvrage :
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail collectif mené depuis le printemps 2023, dont l’ambition est de mobiliser les travaux de nombreuses chercheuses et chercheurs pour analyser, et surtout pour améliorer les réalités du travail en France.
En 2023, les auteurs avaient déjà documenté les difficultés au travail. Ils avaient alors rassemblé sous l’égide du Laboratoire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) un ensemble de contributions sur le travail en France. Ces contributions ont fait l’objet d’un livre , « Que sait-on du travail ? », qui dresse un état des lieux des conditions de travail en France, de la question des risques psychosociaux à celle des travers du management à la Française, en passant par les enjeux des transformations du travail liées à la digitalisation ou au changement climatique. Le constat d’ensemble est plutôt alarmant sur les réalités du travail en France.
Face à ce constat, et aussi parce que les travaux académiques identifient aussi des pistes d’amélioration, les mêmes auteurs ont lancé une deuxième séquence ayant pour objectif de rassembler des propositions concrètes en faveur de meilleures situations au travail. Le recueil de ces propositions, intitulé « Travailler mieux », est disponible sur le site de La vie des idées.
Ces propositions sont formulées dans un format très court, afin d’être comprises et reprises largement. Il s’agit de montrer qu’il y a de nombreuses voies de progrès, qu’elles sont faisables et adaptables. Chaque proposition de mesure suit le même format : identification du problème à résoudre et de l’objectif recherché par la mesure, puis formulation de la proposition dans une forme synthétique susceptible d’être identifiée facilement. Les auteurs de la proposition exposent ensuite les modalités de fonctionnement de la mesure avant de préciser sur quels travaux de recherche la proposition est fondée afin de renvoyer aux approches, aux expériences ou aux exemples concrets qui en démontrent le bon fonctionnement. Enfin, les auteurs suggèrent comment mettre en œuvre la mesure proposée et indiquent ses conditions de faisabilité (négociation, loi, niveau de mise en œuvre, etc.).
Une vingtaine de propositions sont publiées sur le site de La Vie des idées, autour des thèmes suivants :
Renforcer la capacité des salariés à avoir une influence sur la définition et l’organisation de leur travail.
Améliorer la représentation collective des salariés et renforcer les capacités des syndicats.
Limiter les horaires atypiques et fragmentés, les contrats courts.
Garantir de meilleures conditions de formation.
Œuvrer à un travail soutenable.
Réduire les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
On l’aura compris : il s’agit ici de rassembler des perspectives globales et cohérentes sur les voies d’amélioration du travail en matière de qualité des conditions de travail, du management et de l’organisation du travail, des droits d’expression des salariés, de l’organisation et de la maîtrise de l’intelligence artificielle, ou encore de l’écologisation du travail. L’ensemble peut se concevoir comme autant de briques d’un engagement en faveur d’un travail soutenable pour les salariés comme pour les entreprises.
Et maintenant que ce travail universitaire est effectué, il reste à espérer qu’il soit le point de départ de chantiers d’amélioration du travail, aussi bien par des actions législatives et réglementaires que par la négociation sociale et les développements de pratiques vertueuses au sein des entreprises.
Voir la note de lecture de l’ouvrage collectif « Que sait-on du travail ? »
I- Le malaise du travail en France
Les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail, et près des deux tiers d’entre eux affirment que le travail est important. Cependant, pour beaucoup d’entre eux, la vie au travail est difficile : le nombre d’accidents de travail est largement supérieur aux moyennes européennes, les conditions de travail sont souvent moins bonnes que dans les autres pays européens ; de nombreux travailleurs manquent de reconnaissance pour les tâches accomplies ; les problèmes de santé et la perte de sens gagnent de nombreuses professions, y compris celles d’encadrement .
Parmi d’autres, l’ouvrage « Que sait-on du travail ? » (voir plus haut) a documenté et expliqué ces situations difficiles. Il y est montré que les modalités d’organisation du travail sont déterminantes pour expliquer les difficultés rencontrées. Les salariés sont de plus en plus souvent soumis à un management par les chiffres, hiérarchique, vertical et distant, qui laisse peu de place à l’autonomie et à l’horizontalité, et tient rarement compte de la réalité des conditions de production, ou des retours que les personnes concernées souhaiteraient pouvoir faire sur l’organisation du travail.
Par ailleurs, les situations au travail ne sont pas uniformes. De nombreuses inégalités persistent au travail, le plus souvent en défaveur des moins qualifiés, des femmes, de certains jeunes, des handicapés et des personnes issues de l’immigration, et cela malgré la multiplication des plans d’action. Les femmes ont aujourd’hui des taux d’emploi similaires à ceux des hommes, mais elles travaillent beaucoup plus souvent à temps partiel, sont moins rémunérées que les hommes, et leurs carrières restent bloquées par un plafond de verre. Elles sont en outre surreprésentées dans certaines professions, reconnues comme « essentielles » pendant la crise du Covid. Si les désavantages se cumulent fréquemment, il n’en reste pas moins que certaines professions autrefois considérées comme protégées subissent maintenant elles aussi les conséquences négatives de l’intensification du travail (voir les burn-out chez les cadres).
Les difficultés au travail se donnent à voir de multiples façons. Les Françaises et Français manifestent contre une réforme des retraites qui leur demande de travailler plus longtemps dans des conditions perçues par beaucoup comme insoutenables. De nombreux secteurs se retrouvent « en tension » (les employeurs n’arrivent plus à recruter) du fait de rémunérations trop faibles pour des conditions de travail trop difficiles. La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail (Dares) montre que les secteurs où les entreprises déclarent le plus rencontrer des difficultés de recrutement sont la construction, l’hébergement et la restauration, l’agroalimentaire, la fabrication des biens d’équipement, les transports et l’entreposage, secteurs dans lesquels les conditions de travail sont particulièrement difficiles et les niveaux de rémunération souvent plus faibles.
Alors que les maux du travail sont au cœur des préoccupations publiques, il est nécessaire de réfléchir aux solutions permettant d’améliorer la qualité du travail en France. Cette réflexion apparaît d’autant plus importante que le travail se trouve de plus en plus sous pression des multiples transformations en cours, technologiques, environnementales, sociales et politiques.
Voir la vidéo : « Les inégalités femmes-hommes : quels effets réels des mesures prises dans les entreprises ?
II- Un monde du travail en transformation
La réflexion sur l’amélioration des conditions de travail et d’emploi s’inscrit dans un contexte général de tensions liées à de multiples facteurs.
En premier lieu, la poursuite du développement des outils numériques et l’émergence de l’intelligence artificielle constituent une vague d’innovations qui génère des craintes importantes de remplacement de l’homme par la machine, sans pour autant dynamiser la croissance de la productivité du travail. En effet, sur la période 2003-2023, et pour la France, la croissance de la productivité n’est que de 0,4% par an, générant une croissance économique faible. Si les perspectives de croissance ne sont pas au rendez-vous, l’essor du numérique a cependant transformé le monde du travail, en détruisant des emplois qui comportent des tâches routinières, et dont une part importante se situe au milieu de la hiérarchie sociale, affaiblissant ainsi les classes moyennes. Avec le développement de l’intelligence artificielle, cette fragilisation va probablement s’étendre a certains emplois qualifiés de la manipulation d’images, de logiciels ou de documents.
Un second facteur de transformation de la structure de l’emploi provient de la transition écologique. Dans l’ensemble, il y a un potentiel important de créations d’emplois liés à la transition climatique, mais ces créations sont conditionnées à des dépenses publiques importantes et nécessitent aussi un effort de formation et de soutien aux transitions professionnelles. Et il ne faut pas oublier que les emplois « verts » se caractérisent parfois par des conditions de travail difficiles, par exemple dans le traitement des déchets, ou même l’agriculture biologique, et supposent donc un accompagnement spécifique.
Le contexte de risques et de crises constitue une troisième composante de l’environnement du travail en tension. C’est évidemment le cas de crise sanitaire de 2020, crise exogène par excellence, qui a transformé la gestion des ressources humaines et les politiques de l’emploi, avec le recours à l’activité partielle, le développement du télétravail, ou encore les stratégies de flexibilité externe qui réduisent temporairement le volume de salariés en CDD ou en intérim.
Enfin, le contexte politique et social a évolué et modifié également les attentes à l’égard du travail. Si le travail reste important aux yeux des Français, on constate une importance accrue du sens au travail, et ce sens fait défaut dans certains métiers peu qualifiés (caissières, agents de sécurité, …) et dans des métiers qualifiés plutôt bien rémunérés (conseillers et cadres de la banque et des assurances par exemple). De manière plus générale, on observe un lien direct entre le sens du travail (mesuré à partir de l’utilité sociale, de la cohérence éthique, des capacités de développement des compétences) et les comportements des salariés en termes de démissions , de risques d’absence pour maladies diverses.
Voir la note de lecture du livre de Gregory Verdugo « L’intelligence artificielle et l’emploi »
III- La réorientation de la politique de l’emploi
Dans ce contexte de transformations et de défis, il est nécessaire de transformer les politiques de l’emploi.
Jusqu’ici, les politiques françaises de l’emploi n’ont pas été à la hauteur des enjeux de transformation du travail. En effet, les politiques de l’emploi ont été marquées par deux grands axes depuis la crise financière de 2008 : la poursuite de la baisse du coût du travail, lancée avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires en 2013, et la flexibilisation du droit du travail. Sur le premier point, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE adopté en 2013) , puis le pacte de responsabilité (2014) ont conduit à étendre les baisses de coût du travail jusqu’à des niveaux relativement élevés, au nom de la compétitivité de l’industrie française. Mais ces mesures n’ont pas fait la preuve de leur efficacité. Sur le deuxième point, les lois puis ordonnances travail adoptées en 2018 ont contribué à réduire la protection des salariés, notamment en cas de licenciement, et à décentraliser la négociation collective vers l’entreprise sans réellement renforcer les instances de représentation du personnel. Il en a résulté un affaiblissement du dialogue social, dont on peut pourtant penser qu’il est un outil fondamental d’ajustement des entreprises aux transformations technologiques en cours, à la transition écologique, voire aux crises majeures qui marquent l’économie mondiale.
Il est donc aujourd’hui nécessaire de réorienter les politiques françaises en faveur de la qualité de l’emploi et du travail. Les travaux de recherche exposés dans ce livre peuvent contribuer à définir les contours de cette politique de l’emploi. Le premier chapitre propose des mesures générales pour améliorer la qualité des emplois et du travail. Le deuxième chapitre rappelle les difficultés du dialogue professionnel et propose d’instaurer un droit d’avoir son « mot à dire » sur son travail. Le troisième chapitre se demande comment améliorer durablement le management à la française. Le quatrième chapitre traite la question suivante : comment mettre l’intelligence artificielle au service des travailleurs ? Le cinquième chapitre présente les différentes pistes pour relever les quatre défis que pose la transition écologique au travail. Et le dernier chapitre propose aux dirigeants d’entreprise de s’intéresser à la recherche sur le travail, alors que bien souvent ses résultats sont ignorés par ceux-ci.
Finalement, il s’agit pour la France de passer d’une stratégie du « low cost » à une stratégie de la qualité pour toutes et tous. Et cette stratégie de la qualité doit s’appuyer sur différents piliers : la montée en qualité des produits et services made in France ; la dissémination des modalités d’organisation du travail et de management innovantes et inclusives ; la qualité du travail et de tous les emplois ; et la qualification de toute la main-d’œuvre.
Voir la note de lecture du livre de Christine Erhel « Les politiques de l’emploi »
Quatrième de couverture
Les Français, bien que fortement attachés au travail, souffrent d’un manque de reconnaissance, d’un management vertical, de l’intensification et de la digitalisation des tâches qui remettent en question le sens et l’avenir du travail.
Comment améliorer les conditions de travail ? Comment changer ses modalités d’organisation et de management ? Comment utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le travail ? Comment travailler à l’heure du changement climatique ? Comment construire la reconnaissance des professions essentielles ?
S’appuyant sur des expériences et des exemples qui ont fait leurs preuves dans les entreprises et dans les politiques publiques, en France mais aussi à l’étranger, les auteurs de cet ouvrage livrent des propositions pour améliorer la qualité du travail et de l’emploi, à l’heure de la transition climatique et des mutations technologiques.
Les auteurs
Christine Erhel est professeure au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM, Paris), titulaire de la chaire Économie du travail et de l’emploi, et directrice du Centre d'études de l’emploi et du travail (CEET). Elle mène des recherches en économie du travail.
Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS au Centre d’études européennes de politique comparée de Sciences Po. Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales. Il travaille sur les réformes des systèmes de protection sociale.
Ont contribué à cet ouvrage Laurent Cappelletti, Thomas Coutrot, Jérôme Gautié, Nathalie Moncel, Coralie Perez et Anne Rodier.
Les auteurs
Christine Erhel est professeure au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM, Paris), titulaire de la chaire Économie du travail et de l’emploi, et directrice du Centre d'études de l’emploi et du travail (CEET). Elle mène des recherches en économie du travail.
Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS au Centre d’études européennes de politique comparée de Sciences Po. Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales. Il travaille sur les réformes des systèmes de protection sociale.
Ont contribué à cet ouvrage Laurent Cappelletti, Thomas Coutrot, Jérôme Gautié, Nathalie Moncel, Coralie Perez et Anne Rodier.
Questions pour vérifier l’acquis et vous entraîner sur les points abordés
1- Comment expliquer que la vie au travail soit perçue comme difficile par de nombreux Français ?
2- Comment les difficultés au travail des Français se donnent-elles à voir ?
3- Comment l’intelligence artificielle peut-elle affecter la croissance et l’emploi ?
4- Pourquoi est-il nécessaire de réorienter les politiques de l’emploi ?
5- Quels sont les éléments d’une stratégie de la « qualité de l’emploi » ?

