Mots-clés : Emploi, Intelligence artificielle, Progrès technique.
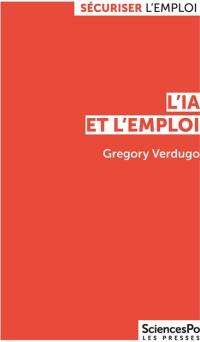
Résumé
L’intelligence artificielle donne la possibilité aux machines de se substituer aux travailleurs. Comme toute phase de progrès technique, elle suscite autant de craintes (sur l’emploi, sur les inégalités ou les libertés) que d’attentes en matière de croissance économique et de libération de l’humanité. Ce livre, en s’appuyant sur les travaux récents des économistes sur le sujet, permet de dépasser cette opposition sommaire et de comprendre plus finement les effets de l’intelligence artificielle sur l’emploi.
L’ouvrage
L’intelligence artificielle (IA) fait référence à l’ensemble des innovations fondées sur les algorithmes d’apprentissage automatique profond (deep learning) et l’utilisation de données massives (big data) qui permettent aux machines d’accomplir de nouvelles tâches. En quelques années, l’IA a rendu possible de traduire un texte en toutes les langues, de reconnaître des mots et des visages, de guider une voiture dans la circulation…. Plus récemment, l’IA générative permet aux machines de créer des contenus visuels ou écrits, d’écrire des poésies, de produire des photos et même des vidéos. Les limites de ces techniques semblent rapidement repoussées grâce aux investissements massifs réalisés. A eux seuls, les 4 géants Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont prévu d’investir plus de 300 milliards de dollars dans l’IA en 2025, après avoir déboursé 246 milliards en 2024 et 150 milliards en 2023.
En donnant la capacité aux machines de remplacer les travailleurs dans des professions jusque-là protégées du progrès technique, l’IA ravive une série de craintes. La première (développée plus particulièrement dans ce livre) est qu’elle risque d’entraîner un chômage technologique pour tous ceux dont le travail deviendra obsolète. La deuxième crainte est que la concentration des nouvelles technologies au sein d’une poignée de géants du numérique ait pour conséquence que l’IA ne profite qu’à une petite élite. Et la dernière crainte réside dans le fait qu’en absence de régulation, on finisse par assister à l’émergence d’une « société de surveillance » dans laquelle employeurs et gouvernements, unis dans le même but, traquent chacun de nos faits et gestes.
A côté de ce techno-pessimisme coexiste une vision techno-optimiste pour laquelle l’IA prolonge les révolutions technologiques précédentes qui furent à l’origine d’un accroissement inédit des richesses matérielles pour l’humanité. S’il est vrai que chaque vague d’innovation bouleverse l’économie en entraînant des coûts inégalement partagés (que l’on se rappelle le processus de destruction créatrice cher à Schumpeter), il n’en reste pas moins que l’IA devrait être la source d’une nouvelle révolution industrielle qui, comme les précédentes, libérera les travailleurs des corvées fastidieuses et enrichira l’humanité. Sur le marché du travail, l’IA augmentera la productivité de nombreux emplois en automatisant de nombreuses tâches pénibles et monotones, permettant ainsi aux travailleurs de se concentrer sur les tâches les plus valorisantes.
L’ouvrage de Verdugo se propose de dépasser l’opposition simpliste entre les techno-optimistes et les techno-pessimistes en présentant l’état de la recherche la plus récente en économie sur les conséquences de l’IA sur le marché du travail. Sans aucun doute, la technologie de l’IA va s’immiscer de plus en plus dans le quotidien des travailleurs, mais il est probable que son utilisation restera circonscrite à des tâches précises et qu’on n’assistera pas à l’arrivée rapide de gains de productivité. Les conséquences à moyen terme de l’IA sur l’emploi restent incertaines, d’autant plus que les révolutions technologiques ont toujours surpris leurs contemporains. C’est ainsi que Daron Acemoglu (« The Real Threat to American Prosperity », Financial Times, 8 février 2025) entrevoit un krach des investissements dans l’IA à l’horizon 2030, qui pourrait se produire quand les investisseurs prendront conscience que les gains de productivité seront plus modestes et plus longs que prévu à se matérialiser. Mais cette correction, si elle se produit, ne sonnera pas le glas de l’IA, mais marquera plutôt l’avènement d’une phase plus mature dans laquelle les possibilités et les limites de cette technologie seront appréhendées de manière plus réaliste.
Regarder la vidéo « L’intelligence artificielle : avec ou contre nous ? ». Trois questions à Rodolphe Gelin et Olivier Guilhem
I- Une technologie à usage général
Les grandes vagues de révolution technologique sont déclenchées par des innovations particulières que les économistes désignent comme des technologies à usage général qui présentent trois caractéristiques : elles se diffusent dans l’ensemble des secteurs de l’économie ; elles présentent un potentiel d’amélioration technique important, permettant de réduire leur coût régulièrement (ce qui permet leur généralisation) ; elles génèrent de multiples innovations complémentaires et sont ainsi à l’origine de nouveaux produits, et parfois d’industries entières.
Les technologies à usage général sont rares. Selon les économistes, jusqu’à l’IA qui pourrait rejoindre la liste bientôt, seules trois technologies à usage général se sont succédé : la machine à vapeur, l’électricité, et l’informatique. Concernant l’IA, il semble bien qu’elle remplisse les trois critères que l’on vient d’évoquer. Tout d’abord, bien qu’à l’origine ses premiers développements étaient limités à la reconnaissance d’images ou de voix, son utilisation s’est étendue au-delà de ces domaines. L’IA occupe désormais une place dans une majorité d’entreprises, tous secteurs confondus. Ensuite, il semble bien que l’IA contribue aux innovations technologiques des autres secteurs : par exemple, Alphafold, une filiale d’Alphabet, présente des applications dans la recherche médicale qui pourraient aider à comprendre l’origine de certaines maladies neurodégénératives, et aussi à aider à combattre des maladies infectieuses comme la tuberculose et la malaria. De manière plus générale, dans de nombreux domaines, l’IA pourrait ouvrir la voie à des découvertes majeures. Enfin, troisième critère, l’IA permet d’inventer de nouveaux produits et services. Dans le domaine des transports, les voitures autonomes et les assistants à la conduite sont pilotés par l’IA. Dans la santé, des sociétés comme Merative automatisent les diagnostics médicaux à partir d’algorithmes entraînés sur de grandes bases de données médicales. En finance, l’IA anime des robots-conseillers qui fournissent des conseils en investissement et en placement, et génèrent automatiquement des portefeuilles d’actifs.
Cependant, si la vague d’innovation que représente l’IA peut offrir des gains de productivité à long terme, l’expérience historique suggère que ses effets sont rarement immédiats. Pour produire une nouvelle technologie, les entreprises doivent investir dans de nouveaux équipements et trouver la manière la plus efficace de les utiliser, deux processus qui demandent du temps. Il a fallu un siècle pour que le moteur à vapeur remplace la voile dans le transport maritime. L’électricité a mis entre trente et quarante ans avant de devenir la principale source d’énergie dans l’industrie. Pour l’informatique, le paradoxe de Solow illustre que la productivité a stagné des années 1980 jusqu’au début des années 1990, malgré les investissements massifs dans cette technologie, avant que les gains de productivité ne se concrétisent tardivement à la fin des années 1990. Et en ce qui concerne l’IA, les prévisions sont diverses. Selon l’économiste Erik Brynjolfsson, en raison de faibles rendements initiaux, la productivité dans la décennie à venir pourrait suivre une courbe en J, avec un effet initial de l’IA faible, voire négatif, sur la productivité. Toujours concernant le décennie à venir, Daron Acemoglu anticipe un effet positif, mais limité, avec une croissance annuelle moyenne des gains de productivité de 0,7%. Et de leur côté, à plus long terme, Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Busnel évoquent le fait que les limites à la croissance pourraient provenir de la résistance durable de certaines tâches à l’automatisation, suivant en cela la loi de Baumol appelée aussi « maladie des coûts » (en 1960, William J. Baumol avait observé qu’en raison des gains de productivité importants dans les secteurs agricoles et industriels, la part de ces secteurs dans les économies ne cessait de diminuer, alors que dans le même temps la part des services qui résistaient à l’automatisation ne cessait d’augmenter, ce qui avait pour conséquence la diminution de la productivité dans l’ensemble de l’économie). De la même manière, selon Philippe Aghion et ses coauteurs, la spécialisation grandissante des économies des pays avancés dans des secteurs où le progrès technique est limité réduit le potentiel de croissance. Toutefois, ce phénomène n'a rien d’inéluctable : l’IA pourrait contrebalancer cet effet en devenant un facteur central dans la production d’idées, et tout particulièrement dans la recherche. Si l’IA automatise une part importante des tâches des chercheurs, elle générera une croissance durable sans nécessiter que le nombre de chercheurs n’augmente.
Voir la note de lecture du livre de Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Busnel, « Le pouvoir de la destruction créatrice »
II- Progrès technologique et emploi
La diffusion d’une technologie à usage général bouleverse le marché du travail. Chaque technologie à usage général a suscité la peur d’un chômage technologique. De Ricardo au XIXème siècle et Keynes au début du XXème siècle à Jérémy Rifkin qui, en 1995, prédit la fin du travail, de nombreux penseurs ont régulièrement alerté sur les dangers de la technologie qui rendraient le travail inutile. Cependant, aucune loi économique ne garantit que l’adoption d’une nouvelle technologie ne baisse massivement la demande de travail. En effet, les gains de productivité induits font baisser les prix, ce qui enrichit le consommateur et augmente son pouvoir d’achat, et ces gains de pouvoir d’achat profitent à la demande de travail. De plus, une autre conséquence du progrès technique réside dans l’apparition de nouveaux biens en services, avec de nouveaux métiers qui deviennent des sources importantes d’emploi. Mais si les baisses de prix et l’apparition de produits et de services nouveaux bénéficient au consommateur, le progrès technique a un effet plus ambigu sur les inégalités entre travailleurs. Et cet effet varie selon les vagues technologiques. Si on se limite à la dernière technologie à usage général avant l’IA, à savoir l’informatique, il est clair qu’elle a profondément influencé les inégalités sur le marché du travail. Dans les années 1980, lorsque les entreprises s’équipent en ordinateurs, elles embauchent plus de cadres et les paient aussi de mieux en mieux. Les économistes parlent d’un progrès technique biaisé lorsqu’il réoriente la demande de travail des entreprises vers les travailleurs les plus qualifiés, au détriment des autres qui subissent la concurrence des machines qui automatisent leur travail. Toutefois, ce modèle du progrès technique biaisé ne rend pas compte d’une autre transformation spectaculaire du marché du travail ces dernières décennies : la polarisation de l’emploi. La hausse des inégalités de salaire masque en effet une recomposition importante de l’emploi entre les professions. Quand on compare l’évolution des différentes professions depuis les années 1980, celles dont les effectifs reculent ne sont pas les moins payées, comme le prédit le modèle du changement technique biaisé, mais les professions intermédiaires situées au milieu de la distribution. La polarisation de l’emploi désigne cette hausse simultanée des emplois bien payés de cadres et des emplois peu payés dans les services, alors qu’au même moment la part des emplois intermédiaires diminue proportionnellement. Et pour expliquer cette polarisation, Daron Acemoglu et David Autor distinguent trois types de tâches : les tâches routinières, les tâches non routinières, et les tâches abstraites. Les tâches routinières sont suffisamment prévisibles pour être décomposées puis codées dans un programme informatique en une série d’instructions élémentaires. Ces tâches routinières (comme celles de l’employé de banque) étaient auparavant exécutées par les travailleurs des professions intermédiaires. Les tâches non routinières, qui sont souvent des tâches manuelles simples (comme celles du cuisinier dans un restaurant ou de l’aide à domicile), sont difficilement automatisables, car elles requièrent de posséder de la flexibilité dans un environnement changeant. Elles échappent aux conséquences de l’informatisation et de la numérisation. Quant aux tâches abstraites, puisqu’elles demandent de résoudre des problèmes complexes en utilisant des capacités d’intuition, de créativité et de persuasion, elles ne sont pas non plus automatisables. Elles ne subissent pas la concurrence des ordinateurs, mais l’ordinateur a permis d’augmenter leur productivité en effectuant des calculs, en manipulant, triant ou échangeant des informations.
Quels seront les professions et les travailleurs les plus touchés par l’implantation de l’IA, sachant que celle-ci s’immiscera dans un grand nombre de professions ?
Dans quelques rares activités, l’IA supplante déjà le travail humain, ne laissant aucune tâche non automatisée (Exemple : la traduction automatique remplace les traducteurs sur les sites d’Airbnb et d’Amazon). Dans des professions aux tâches plus variées, l’effet de l’IA est plus nuancé et souvent positif sur la qualité du travail : elle automatise une partie des tâches, et libère du temps pour des tâches plus complexes et valorisantes. Dans d’autres activités, l’IA ne se substitue pas aux travailleurs, mais joue un rôle de copilote. Les agents conversationnels (chatbots), dirigés par de grands modèles de langage, ont des effets spectaculaires sur la productivité. Dans certaines situations d’ailleurs, les grands modèles de langage ont des performances supérieures à celles des travailleurs expérimentés. Dans le cas de la médecine, on a pu ainsi constater dans une expérimentation que les réponses des assistants virtuels sont supérieures à celles des médecins, à la fois dans leur qualité et également dans le degré d’empathie face à la situation des patients. Selon David Autor, les grands modèles de langage auront un impact profond sur ces professions relevant de « tâches abstraites ». L’IA générative pourrait de la sorte démocratiser l’accès à des tâches réservées aujourd’hui aux ingénieurs, juristes et médecins, qui ont accumulé une expérience relativement rare sur le marché du travail par des années d’apprentissage. Au total, et à ce stade, on peut dire que les conséquences de l’IA à long terme sur l’emploi et les salaires sont ambiguës, car l’automatisation peut être contrecarrée par des mécanismes porteurs d’effets positifs (comme les vagues précédentes de technologie générale). Néanmoins, si l’IA ne diminue pas le nombre d’emplois, ses coûts et ses bénéfices peuvent être répartis de manière inégalitaire. Une augmentation des emplois d’ingénieurs de requête n’aide pas forcément les travailleurs de la santé et de la finance, pour qui il apparaît difficile de se reconvertir à ces nouvelles technologies. Même si l’économie sort gagnante, la transition technologique a un coût de reconversion important pour de nombreux travailleurs, considérés jusque-là comme des « travailleurs très qualifiés ».
Voir les notes de lecture :
Le livre de Daniel Susskind « Un monde sans travail » et le livre d’Ariel Reshef et Farid Toubal « La polarisation de l’emploi en France »
III- S’adapter à l’IA
Les institutions évoluent moins vite que les nouvelles technologies. Or, pour tirer pleinement profit de celles-ci, il est nécessaire de réformer ces institutions. On peut illustrer cela à différents niveaux : éducatif, politique, et économique.
La première institution qui doit évoluer est l’éducation. En effet, les grands modèles de langage sont devenus une source de connaissance qui transforme la manière dont les étudiants apprennent. A des questions sur toutes sortes de thèmes, ces grands modèles offrent des réponses d’une qualité supérieure à ce que la plupart des étudiants peuvent produire à leurs débuts. Une requête en langage courant adressée à un grand modèle de langage se révélera par exemple d’une efficacité redoutable pour résoudre des problèmes de mathématiques de l’école primaire jusqu’au lycée, et parfois au-delà. L’IA peut également être mise au service des enseignants afin de les guider dans l’adoption de meilleures pratiques. Ainsi, il existe déjà des robots de conversation destinés aux enseignants qui les conseillent sur la meilleure manière de guider les élèves vers de bonnes réponses. Si donc l’IA peut changer rapidement les manières d’enseigner et d’apprendre, il n’en reste pas moins que ses usages doivent être réglementés et pilotés. En effet, dans un certain nombre de cas, l’IA peut aussi dégrader l’apprentissage en offrant des réponses toutes prêtes aux problèmes soumis. Dans ces cas, elle remplace les efforts indispensables des apprenants pour développer leur capacité à résoudre des problèmes et à exercer leur pensée critique. Une IA mal pilotée peut même réduire la productivité.
Au niveau politique, il convient de prendre des dispositions pour combler le retard européen. Pour le moment, les grandes firmes de l’IA, telles que Nvidia, OpenAi ou Anthropic, sont basées en Amérique du Nord aux côtés d’acteurs établis comme Microsoft, Google ou Meta. La recherche dans le domaine de l’IA est aussi largement concentrée outre-Atlantique : dans la production de brevets sur l’IA, l’Europe est largement distancée par la Chine et les Etats-Unis. De plus, si les entreprises européennes adoptent l’IA au même rythme que leurs concurrentes états-uniennes, elles sont spécialisées dans des secteurs plus éloignés de l’innovation, comme le luxe et l’automobile. Le retard européen s’explique de plusieurs manières. En premier lieu, la recherche fondamentale produite par les universités est mieux valorisée économiquement outre-Atlantique. La recherche européenne, et notamment française, possède de nombreux points forts, mais elle est rarement poursuivie et transformée en application industrielle, car les politiques publiques n’encouragent pas assez les relations entre recherche fondamentale et entreprise. En second point, le retard européen provient également du fait que les sources de financement pour la croissance de start-up innovantes sont plus rares. Le système financier européen repose sur un financement principalement réalisé par les banques, et celles-ci ont tendance à privilégier les secteurs les plus sûrs. Or, en raison de son niveau de risque élevé, le financement de start-up se fait essentiellement avec des fonds d’investissement en capital risque, qui sont quasiment absents en Europe, malgré quelques progrès récents. Enfin, un troisième obstacle majeur à l’IA en Europe est la complexité de l’appareil juridique encadrant son utilisation. Pour des raisons historiques, la protection de la vie privée a toujours été plus forte sur le continent européen qu’aux Etats-Unis. C’est ainsi que le rapport sur la compétitivité européenne remis en septembre 2024 par Mario Draghi souligne la complexité du cadre juridique du traitement des données dans l’Union.
Au niveau économique, il s’agit de préserver un certain degré de concurrence sur le marché de l’IA. Or, deux principaux facteurs peuvent aboutir à des situation d’oligopole, voire de monopole, sur ce marché : la capacité des firmes innovantes à s’approprier les innovations en déposant des brevets, et l’évolution des coûts de développement des nouveaux modèles. Si jusqu’à présent, les brevets n’ont pas réussi à limiter la concurrence, le coût du développement des modèles d’IA constitue une barrière majeure à l’entrée. En effet, puisque la performance des modèles dépend de leur coût de développement, et que les consommateurs préfèrent les modèles les plus performants, cela devrait conduire à un marché très concentré autour d’une poignée de grandes firmes ayant assez de ressources pour financer le développement des modèles les plus avancés. Il faut dire aussi que les importants besoins en énergie nécessaires pour calculer les paramètres des modèles, puis les faire fonctionner, poussent également vers la concentration. Une requête sur un grand modèle de langage consomme 10 fois plus d’énergie qu’une recherche traditionnelle sur un moteur de recherche comme Google. Dans ces conditions, seules les firmes ayant accès à de l’énergie bon marché disposeront d’un avantage concurrentiel décisif. Pour maintenir une certaine concurrence dans le secteur de l’IA, une régulation de ce marché par les pouvoirs publics sera probablement nécessaire.
Toutefois, cette évolution vers une situation où, tôt ou tard, un seul gagnant « rafle la mise », n’a rien d’inéluctable, comme en témoigne l’apparition de Deepseek le 20 janvier 2025. Sans disposer des avantages des géants américains du secteur, cette petite start-up chinoise a surpris le monde en dévoilant R1, un grand modèle de langage dont les performances sont comparables à celles des modèles les plus avancés des entreprises américaines.
Voir l’enregistrement de la conférence « l’IA en Europe » donnée dans le cadre de EEE 2025
Cliquez sur le lien ==>
Quatrième de couverture
L’intelligence artificielle est déjà inscrite dans les pratiques quotidiennes des populations. Ses applications effectives ou fantasmées semblent d’autant plus sans limite qu’elle appartient à la catégorie exceptionnelle des nouvelles technologies à usage général, c’est-à-dire capables de se répandre dans l’ensemble des secteurs de l’économie.
Si sa diffusion ravive les craintes que le progrès technique entraîne une crise inédite de l’emploi, elle laisse entrevoir une nouvelle révolution industrielle qui, comme les précédentes, libérera l’humanité de fastidieuses corvées et l’enrichira.
Dans les faits, elle donne d’ores et déjà, dans de nombreuses activités, la capacité aux machines de se substituer aux travailleurs. Ce remplacement n’est pas sans danger. L’IA risque d’amplifier des discriminations présentes dans nos sociétés. Elle fournit, en outre, des moyens excessifs de surveillance des salariés.
Afin de comprendre plus finement les effets de l’IA sur l’emploi, cet ouvrage propose une synthèse des derniers travaux des économistes sur cette transformation déjà en cours.
L’auteur
Gregory Verdugo est professeur des universités en sciences économiques à CY Cergy Paris Université et chercheur associé à l’OFCE. Il est notamment l’auteur, dans la même collection, des Nouvelles inégalités du travail (Presses de Sciences Po, 2017).
Questions pour vérifier l’acquis et vous entraîner sur les points abordés
1. L’IA peut-elle être qualifiée de « technologie à usage général » ?
2. IA et gains de productivité
3. A partir de l’exemple de l’IA, montrer comment les institutions peuvent freiner ou accompagner le développement des nouvelles technologies
4. L’IA a-t-elle les mêmes conséquences sur l’emploi que les révolutions technologiques précédentes ?
5. La concentration du marché de l’IA est-elle inéluctable ?


