Mots-clés : économie mondiale, guerre commerciale, guerre des monnaies, progrès technique, ressources naturelles, politiques industrielles
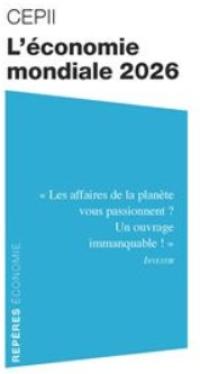
Résumé :
L’économie mondiale est confrontée à de nombreuses tensions qui prennent la forme de guerres commerciales, d’une guerre technologique, d’une guerre monétaire et d’une guerre autour des ressources naturelles critiques.
L’ouvrage :
« L’économie mondiale est en guerres, au pluriel. » C’est ainsi que les deux économistes Isabelle Bensidoun et Jézabel Couppey-Soubeyran, directrices de l’ouvrage, ouvrent ce nouvel opus de L’économie mondiale. Les guerres sont en effet nombreuses. Il y a bien évidemment les guerres qui relèvent directement de la géopolitique – mais qui ont des effets économiques notables – comme le conflit russo-ukrainien ou encore la riposte israélienne à Gaza. Mais les auteurs dénombrent aussi des guerres de nature directement économique : guerres commerciales, guerres technologique, guerre des monnaies ou encore guerre autour des ressources naturelles. Ces différentes guerres élèvent considérablement le niveau d’incertitude qui entoure l’économie mondiale, ce qui conduit à des prévisions de croissance mondiale de plus en plus faibles dans les prochaines années.
Dans leur article, « Vue d’ensemble : l’économie mondiale en guerres », Isabelle Bensidoun et Thomas Grjebine soulignent à juste titre combien cette croissance mondiale fragilisée provient des trajectoires (devenues) incertaines des deux plus grandes puissances économiques : les États-Unis et la Chine.
La position (économique) de la Chine semble, à première vue, bien meilleure que celle de son rival américain. Toujours en excédent commercial, l’économie chinoise vient de signer un nouveau record en la matière pour ce qui concerne les biens manufacturés : 1,9 % du PIB mondial en 2023 (bien au-dessus des records allemands du début des années 2000 qui s’élevaient au mieux à 0,8 % du PIB mondial). La Chine est également parvenue au bout de son processus de remontée des filières, avec une nette montée en gamme de l’industrie et un fort développement technologique. Pour autant, ces indicateurs (réels) sont trompeurs car ils masquent le déséquilibre structurel du modèle de croissance économique de la Chine : en dépit de leur résolution, les autorités ne parviennent pas à suffisamment dynamiser la demande interne. Les subventions massives dans les secteurs stratégiques (automobile, batteries etc.) se traduisent alors par des surcapacités industrielles dont les biens s’écoulent d’abord sur les marchés extérieurs. Dans un contexte de rivalité hégémonique avec les États-Unis, alors que les pays développés se montrent moins naïfs devant les ressorts de la compétitivité chinoise et que l’économie mondiale est devenue un « champ de bataille », les débouchés internationaux des biens fabriqués en Chine ont tendance à se raréfier. Avec une offre toujours plus importante mais une demande intérieure structurellement faible (et qui ne décolle pas) et une demande extérieure plus incertaine, l’économie chinoise semble avancer tout droit vers une déflation. Un déséquilibre dont il est très difficile de sortir comme le montre l’épisode de déflation rampante rencontrée par le Japon pendant 30 ans (1990-2020).
De son côté, les États-Unis sont responsables d’une montée en tension autour du commerce international. Après la « mondialisation entre amis » promue sous l’administration de Joe Biden, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche s’est traduit par une logique de coercition commerciale (et donc par l’interruption des politiques industrielles verticales qui commençaient à porter leurs fruits outre-Atlantique). Le président américain actuel a choisi d’user du rapport de force tous azimuts, quasiment avec le monde entier, alors que lors de son premier passage à la Maison Blanche, l’essentiel de ses attaques étaient concentrées sur la Chine. Au total, ce sont 57 pays qui ont été visés par des droits de douane. En usant d’un unilatéralisme provocateur, Donald Trump entend ainsi atteindre un double objectif : rééquilibrer la balance des transactions courantes de l’économie américaine qui est, en effet, structurellement déficitaire et favoriser la réindustrialisation de son territoire. Les droits de douane servent d’abord à entrer en position de force dans les négociations avec les pays concernés, de façon à obtenir des accords favorables (à l’instar de celui qui a été conclu avec l’Union européen qui peut tout à fait être vu comme une « capitulation » ou une « humiliation »). Donald Trump a souvent atteint son but de ce point de vue mais pas avec la Chine. La montée aux extrêmes tarifaires entre les deux rivaux stratégiques (autour de 125 % respectivement à l’entrée des deux marchés) s’est finalement terminée par une désescalade : la Chine ne s’est pas démontée, au point de contrôler et de limiter les exportations sur les terres rares dont ont tant besoin les entreprises technologiques et automobiles américaines.
Les Etats-Unis sont ainsi devenus un hégémon déstabilisateur du monde (à l’opposé de la « stabilité hégémonique » théorisée par Charles Kindleberger). Cette déstabilisation de l’économie mondiale affaiblit nécessaire une croissance mondiale déjà aux prises avec des facteurs conjoncturels (resserrements monétaires effectués par les banques centrales, chocs négatifs sur les chaines d’approvisionnement) et des facteurs structurels qui rappellent le contexte de la stagnation séculaire qui frappe particulièrement les économies développées (ralentissement de la productivité, vieillissement de la population et surabondance d’épargne à l’échelle mondiale). Résultat : le CEPII indique que la décennie 2020 est en passe de devenir la plus faible en matière de croissance économique mondiale depuis la décennie 1960….
Voir la notion : La stagnation séculaire
Voir le fait d'actualité :
Les guerres commerciales voulues par Donal Trump handicapent considérablement les exportateurs européens, en particulier dans le secteur de l’automobile qui est en souffrance. Cette situation rend les défis à surmonter encore plus difficiles pour les firmes automobiles : parvenir le passage à la voiture électrique et rattraper le retard pris sur les nouveaux acteurs chinois et américains – qui sont en train de reconfigurer le marché. De nouvelles politiques industrielles sont ainsi expérimentées en Europe comme le montrent Vincent Vicard et Pauline Wibaux dans leur contribution intitulée « L’automobile, secteur emblématique de la mondialisation et de ses bouleversements ». L’instauration de normes particulièrement contraignantes en matière d’émissions, comme l’interdiction programmée des moteurs thermiques dans l’UE d’ici 2035, apparait comme une condition nécessaire mais non suffisante. La politique industrielle doit aussi s’appuyer sur un soutien fiscal au déploiement d’infrastructures (bornes de recharge) et à la Recherche et développement. Mais également trouver les moyens de créer un écosystème européen compétitif dans le domaine des voitures électriques et des batteries : pour cela, les subventions à l’achat semblent un instrument très important puisqu’elles permettent aux entreprises d’atteindre une taille critique et de se positionner à la frontière technologique (à l’instar de ce qui a été pratiqué en Chine). En outre, le fait que des firmes chinoises cherchent à s’implanter en Europe, pour échapper aux droits de douane et se rapprocher de la demande, doit être une occasion d’inciter aux transferts technologiques vers les acteur locaux, condition importante pour combler le retard.
Lire le fait d'actualité et la note de lecture ...
Outre les guerres commerciales, l’économie mondiale pourrait être frappée par une guerre des monnaies. Donald Trump s’est en effet également lancé dans un néomercantilisme monétaire avec la publication du « Genius Act » (Guilding and Etablishing National Innovation for US Stablecoins, juin 2025) afin que les États-Unis continuent à attirer les capitaux étrangers, nécessaires pour financer ses déficits jumeaux : déficit courant mais aussi déficit public. Il s’agit de développer des stablecoins au dollar, tout en obligeant les émetteurs à détenir des bons du Trésor en réserve, pour que la demande de dollars puisse se maintenir. Une telle disposition, agressive vis-à-vis des autres grandes monnaies – comme l’euro et yuan –, était devenue d’autant plus nécessaire que la loi budgétaire de Trump, le « One Big Beautiful Bill Act », implique plus de dépenses publiques que de recettes fiscales. La stratégie des États-Unis en la matière s’apparente à une forme de « crypto-mercantilisme », faisant des stablecoins un instrument de la suprématie monétaire américaine.
Lire les notes de lecture :
Autour de l’Intelligence artificielle (IA) notamment, la guerre est également technologique. Les développements récents de l’IA placent les économies nationales ou régionales devant un dilemme périlleux : faut-il s’engager dans cette révolution ? Ne pas le faire, c’est risquer de se retrouver vassalisé par les leaders technologiques américains et/ou chinois. Le faire peut conduire à alimenter une course non régulée débouchant sur la face sombre de l’IA : dévalorisation du travail humain, chute des salaires etc. Pour Axel Arqué, auteur de l’article « L’IA, révolution industrielle du savoir : entre progrès technique, déstabilisation sociale et défi lancé à l’humain », un moyen de résoudre ce dilemme serait de confier à la communauté internationale le rôle d’imposer des règles empêchant que certaines limites soient franchies au détriment de l’homme.
Voir le lien sur le programme : EEE 2025 Site Melchior
Enfin, l’économie mondiale pourrait rapidement se retrouver dans une phase « d’insécurité minérale ». Une bataille (moins médiatisée mais tout aussi importante) s’organise autour des ressources naturelles critiques, notamment depuis que la crise Covid a démontré que les interdépendances pouvaient être source de vulnérabilités, puisqu’elles sont indispensables au développement des technologies bas-carbone, du numérique, ainsi qu’aux industries de défense. La rivalité sino-américaine autour des métaux hautement stratégiques a dernièrement redoublé d’intensité. Premier producteur mondial de terres rares et de nombreux métaux critiques (graphite, tungstène, gallium…), la Chine se sert de plus de cette position comme d’un levier géopolitique (Pékin réduit délibérément ses exportations de ressources naturelles critiques pour les réserver à ses industries nationales). Depuis son premier mandat, Donald Trump voit la dépendance de son économie à l’égard de la Chine sur plusieurs métaux critiques comme une menace pour la sécurité nationale de son pays. C’est aussi en relevant l’objectif de réduire la domination chinoise en termes de ressources naturelles critiques que l’on peut comprendre les politiques protectionnistes et la volonté de se réindustrialiser par la relocalisation des chaines de valeur des États-Unis. Les métaux critiques sont ainsi devenus le cœur d’une « diplomatie du sous-sol » qu’analysent avec précision Carl Grekou, Emmanuel Hache et Valérie Mignon dans leur article titré « Métaux critiques : Les Etats-Unis entre impératif de souveraineté et tentation impérialiste ». Les auteurs montrent que les deux hégémons ouvrent la voie à des tensions géoéconomiques qui ne devraient pas se réduire dans le contexte actuel du capitalisme de la finitude.
Voir la note de lecture : Le monde confisqué
Quatrième de couverture :
Chaque année, le CEPII publie dans la collection « Repères » des analyses inédites des grandes questions économiques mondiales.
L’économie mondiale est en guerre, au pluriel : guerre commerciale, guerre technologique, guerre monétaire… Les menaces de droits de douane pleuvent sur le commerce international. Le secteur automobile, déjà à la peine en Europe, pourrait particulièrement souffrir. La rivalité sino-américaine autour des métaux stratégiques risque de faire entrer l’économie mondiale dans une phase d’insécurité minérale. Qui dit guerre, dit sanctions : quel est le bilan de celles prises contre la Russie ? Parmi les bouleversements majeurs qui reconfigurent l’économie mondiale, l’intelligence artificielle : est-elle une alliée ou une ennemie ? Autre sujet de bataille, l’immigration. Pourtant, accompagnée par des politiques d’intégration actives, elle pourrait être un outil de rééquilibrage des évolutions démographiques mondiales qui constituent un autre sujet de préoccupation.
L’auteur :
Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) est le principal centre français de recherche et d’expertise en économie internationale. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d’Isabelle Bensadoun et Jézabel Couppey-Soubeyran.
Questions pour vérifier les acquis et vous entrainer sur le thème :
1. Pourquoi peut-on penser que l’économie chinoise est fragile ?
2. Comment expliquez-vous l’affaiblissement de la croissance mondiale ?
3. En quoi les politiques industrielles peuvent-elles aider l’économie européenne à combler son retard dans le secteur de l’automobile verte ?
4. L’IA représente-elle nécessairement une source de progrès ?
5. Pourquoi peut-on parler d’une « insécurité minérale » mondiale ?







