Mots-clés : Idéologie, Science économique.
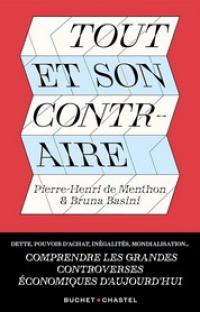
Résumé
Le livre est consacré à l’exposé des grandes controverses qui opposent aujourd’hui les économistes sur les problèmes du monde relatifs aux inégalités, à la mondialisation, à la dette, à l’intelligence artificielle, au climat,… Au total, ce sont quatorze sujets sur lesquels les auteurs fournissent un tour d’horizon assez complet et actualisé.
L’ouvrage
La science économique, dont l’ambition est d’observer les faits, de les analyser, et ensuite d’en tirer des enseignements pour améliorer la prospérité des peuples, déçoit aujourd’hui bon nombre de nos contemporains, et cela pour plusieurs raisons.
La première raison est qu’elle se montre incapable de prévoir les grands événements. Par exemple, en 2008, à l’occasion de la crise des subprimes, la plupart des économistes n’avaient rien vu venir. De même, et de manière plus générale, quand ils énoncent que le doux commerce est bon pour la prospérité, c’est la fragmentation qui l’emporte avec des droits de douane qui s’érigent. Ou encore au moment où ils s’échinent encore à trouver des solutions pour venir à bout du chômage, ce sont les salariés qui ne veulent plus travailler……
La deuxième raison est que la statistique, qui est la matière première de la production de l’économiste, est parfois sujette à caution. Si les données fournies par les sources issues d’Etats non démocratiques ne sont guère fiables (et si c’est même une caractéristique des Etats autoritaires de manipuler les faits), on pensait jusqu’à présent que les datas officielles rendues publiques par les Etats étaient fiables. Mais ce n’est pas toujours le cas. Pour n’en donner qu’un exemple, et pour prendre un exemple récent particulièrement emblématique, à partir du printemps 2024, la direction générale du Trésor en France a constaté avec effroi que les rentrées de recettes fiscales seraient moins importantes que prévu, et donc que le déficit budgétaire serait plus élevé qu’annoncé (en un an, la prévision du déficit est passée de 4,1% à 6,1% du PIB).
Mais ces deux premières raisons ne sont pas si importantes que cela. Après tout, il n’est pas dans la mission d’une science de prévoir l’avenir, et on sait depuis longtemps que les « faits » n’existent pas sans un regard approfondi sur le mode de production de ceux-ci. La troisième raison, cependant beaucoup plus importante que les deux premières, est l’absence de consensus chez les économistes. Dans « La cité des savants » (expression de Bachelard), on s’accorde sur ce qui a été démontré et testé, laissant débats et controverses aux seules recherches en cours, qui portent sur ce que l’on ne sait pas encore. Mais entre économistes, on semble s’opposer sur tout, y compris sur les choses les plus fondamentales. Le livre de Pierre-Henri de Menthon et Bruna Basini fait le point sur les idées développées par les différentes « chapelles » ou « tribus » d’économistes sur les grands sujets que sont les inégalités (Les riches sont-ils utiles au bonheur des peuples ?), la dette (Faut-il la rembourser ou la creuser ?), la Chine (Tigre rugissant ou tigre de papier ?), la guerre (Destruction créatrice accélérée ou destruction pure ?), la mondialisation (Nuisible ou bénéfique, et pour qui ?), l’inflation (Une maladie, un bienfait, ou un mal nécessaire ?), la démocratie (nécessaire ou pas à la croissance économique ?), le climat (Quel sera son impact sur la croissance ?), le Vatican (Peut-on qualifier la théorie économique de l’Eglise d’hétérodoxe ?), le travail (Grande démission ou revigorante utopie ?), l’intelligence artificielle (Le grand enrichissement ou le grand remplacement ?), les libertariens (Faut-il détruire l’Etat ou faire de l’individualisme une religion ?), les cryptomonnaies (Dystopie fiduciaire ou la plus grande aventure monétaire du XXIème siècle ?). Dans les lignes qui suivent, on retiendra les débats en cours sur les questions importantes que sont la démocratie, la guerre, et l’intelligence artificielle.
Si donc le doute est permis sur l’activité des économistes, et malgré cette cacophonie apparente, il n’en reste pas moins que la science économique est plus que jamais nécessaire car elle permet à l’honnête homme de s’informer et de prendre position sur les grands sujets du monde. Comme le dit André-Comte Sponville dans sa préface au livre, « l’économie est une chose trop importante pour l’abandonner aux économistes, et trop compliquée pour qu’on puisse se passer d’eux ! ».
Voir la note de lecture du livre de Dani Rodrick « Peut-on faire confiance aux économistes ? »
I- La démocratie
Quel est le lien entre les institutions politiques et la croissance ? La prospérité est-elle fille de la démocratie ou inversement ?
Selon Martin Wolf (The Crisis of Democratic Capitalism,2023), c’est l’économie qui commande. A titre d’illustration, ce serait selon Wolf la dépression économique marquée par l’hyperinflation et la flambée du chômage qui a fait basculer l’Allemagne des années 1930 dans le pire des totalitarismes. Cette certitude que l’économie dicte et domine l’histoire est d’ailleurs partagée par Joseph Schumpeter dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942). Selon lui, la démocratie est une forme de marché « aboutissant à des décisions, dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur des décisions à l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple ». Au passage, Karl Marx et Friedrich Engels appuyaient également leurs théories sur le déterminisme économique. Et concernant la période actuelle, un certain nombre d’auteurs (dont Angus Deaton) évoquent le fait que ce sont les malheurs des classes populaires et la montée des inégalités dans leur propre pays qui sont à l’origine de la crise des régimes démocratiques. Pour Branko Milanovic, si le capitalisme domine désormais sans partage, il prend des formes très différentes, comme le capitalisme anglo-saxon d’une part et le capitalisme chinois d’autre part, qui sont l’un comme l’autre menacés par des démons très peu démocratiques que sont la ploutocratie occidentale et la corruption post-communiste. Et seules des mesures hardies comme la lutte contre les inégalités et des réformes structurelles d’ampleur peuvent permettre de stopper l’autodestruction démocratique.
Cette théorie du déclin démocratique n’emporte pourtant pas tous les suffrages. James A. Robinson et Daron Acemoglu (Why Nations Fail, 2012), en se penchant sur l’histoire de long terme, affirment que la démocratie est nécessaire pour amorcer le développement économique. Ils rejoignent par là-même les intuitions de quelques grands auteurs du XVIIIème siècle, puisque pour Montesquieu aussi bien que pour Adam Smith, les institutions politiques de la Hollande et de l’Angleterre, plus ouvertes que dans les autres régions du monde (et tout particulièrement la France de l’Ancien Régime), ont favorisé l’essor économique précoce de ces deux pays. Pour Acemoglu et Robinson, l’absence de croissance soutenue avant 1800 est liée au fait que « toutes les sociétés vivaient sous des régimes autoritaires ». L’autoritarisme est la pente naturelle d’un pouvoir résolu à défendre ses positions et « empêcher toute forme de destruction créatrice ». Faute de nouvelles entreprises et de nouvelles techniques, et faute d’accepter de prendre des risques, les économies végètent. Dans d’autres contributions, Acemoglu reconnaît que les régimes autoritaires peuvent générer de la croissance, mais celle-ci ne saurait être durable. Selon l’économiste turc, la phase de croissance de la Chine s’arrêtera probablement vers 2030 en raison de l’absence de démocratie dans ce pays.
D’une manière plus générale, Acemoglu conclut que s’il y a un lien clair entre les institutions qui encouragent une large participation aux affaires des différents groupes de la société tout en assurant le respect des droits de propriété, et la croissance économique, le lien inverse n’est pas évident. La croissance économique ne génère pas forcément la démocratie. Des dictatures peuvent être à l’origine de « miracles économiques ». Par exemple, les années de paix du IIIème Reich furent rayonnantes avec une croissance moyenne du PIB annuel de 10% sur la période 1932-1939, et un retour au plein-emploi. De même, le pari américain de favoriser l’essor de la Chine en acceptant son entrée dans l’OMC, sous prétexte que cela favoriserait la démocratisation du régime, n’a pas été gagnant.
L’histoire récente illustre hélas la pertinence de cette dernière idée. La croissance américaine actuelle est relativement forte alors que le pays est menacé par la montée du populisme. Quant à la Chine, même si elle est actuellement exposée à une démographie déclinante et une crise immobilière qui s’éternise, elle continue de croître dans un cadre parfaitement non démocratique.
Voir le prix Nobel d’économie 2024
II- La guerre
L’irruption de la guerre en Ukraine en 2022 a surpris les économistes. Il est vrai que la plupart d’entre eux, à l’image de Léon Walras, sont des pacifistes. Ce dernier, libéral, et suisse d’adoption, affirmait en effet que le libre-échange devait permettre de supprimer les armées, car les arbitrages internationaux étaient là pour résoudre pacifiquement les conflits. Après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, on a vu cependant fleurir les articles des économistes sur la guerre, qui comme d’habitude affichent des désaccords importants sur le sujet.
Pour le néo-schumpetérien Philippe Aghion, la guerre et les dépenses militaires sont un soutien à la croissance et font avancer l’innovation. C’est ainsi qu’il observe que, à la suite de la guerre de 1914-1918, le nombre de brevets déposés en France entre 1920 et 1930 s’élève à plus de 60% au-dessus des chiffres moyens de la décennie précédant la guerre. Comment expliquer cela alors que cette guerre a fait périr en France près de 15% de la population active masculine, et aussi fait péricliter certains domaines scientifiques particulièrement affectés par la disparition des talents emportés dans les combats ? L’explication avancée par Antonin Bergeaud et Jean-Baptiste Chaniot (enseignants à HEC et membres de l’Innovation Lab au Collège de France) est que le choc démographique pousse à innover. Le mécanisme à l’œuvre est très proche de la destruction créatrice chère à Schumpeter. La contraction de l’offre de travail liée à l’hécatombe provoque une hausse des salaires et une pénurie de main-d’œuvre telles que les entreprises sont contraintes à innover pour substituer des machines aux travailleurs disparus et pour augmenter la productivité des employés restants.
Cette thèse d’une « pression créatrice » liée à la guerre n’était cependant pas partagée par Schumpeter lui-même. Dans ses écrits des années 1930 sur les cycles économiques, il rejetait en effet par principe l’idée de retombées économiques positives des conflits et de la hausse des dépenses militaires. Cette thèse est également partagée de nos jours par Patrick Artus. Selon ce dernier, la guerre est synonyme de récession, et l’idée même que les dépenses militaires sont un soutien à la croissance grâce à leur contenu technologique ne se vérifie pas. On produit pour l’essentiel des matériels souvent peu sophistiqués comme des obus ou des chars, qui utilisent l’emploi disponible de manière inefficace. C’est le problème actuel de la Russie, qui a transféré une partie de sa population active dans l’industrie de l’armement. Les dépenses militaires ne sont pas corrélées à la productivité, à l’exception toutefois des Etats-Unis, où on constate que ces dépenses ont un impact réel sur l’innovation.
En revanche, les auteurs se rejoignent pour dire qu’une guerre est a posteriori bénéfique dans sa phase de reconstruction intervenant après la destruction du capital, qui va être remplacé par du capital neuf. C’est le cas de l’Europe qui a connu pendant les « Trente Glorieuses » une période marquée par une croissance forte, avec un gros effort d’investissement et des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, avec des déficits élevés et des taux d’intérêt artificiellement bas.
On notera au passage que le débat se poursuit sur l’intérêt des sanctions ou « réparations » pour faire payer un agresseur. On se souvient que Keynes en 1919 dans « Les conséquences économiques de la guerre » s’opposait à l’idée de faire payer l’Allemagne, parce que le niveau élevé des réparations prévues allait causer selon lui le risque d’une nouvelle guerre. A Paris, deux économistes réputés s’opposaient également sur cette question des réparations. D’une part, Charles Rist (1874-1955) affirmait que les dispositions du traité de Versailles étaient inapplicables (les indemnités payées par l’Allemagne ont d’ailleurs été suspendues dès 1924). D’autre part, Jacques Rueff (1896-1978) militait pour le maintien des paiements et le lancement d’un grand emprunt pour reconstruire l’Allemagne. Mais au bout du compte la crise monétaire a emporté le République de Weimar avant qu’un tel projet puisse être échafaudé.
Voir le fait d’actualité sur le « keynésianisme militaire »
III- L’intelligence artificielle
L’IA, grâce à la masse gigantesque de données dont elle dispose et à la puissance de calcul des ordinateurs, peut effectuer en une fraction de seconde des opérations inaccessibles aux humains. Doit-on en attendre un enrichissement de nos compétences ou prépare-t-elle notre remplacement ? Apportera-t-elle à l’économie des gains de productivité importants ? Ces questions ont relancé le vieux débat au sein du monde des économistes entre les techno-optimistes et les techno-pessimistes.
Les techno-optimistes pensent que la robotisation ne va pas remplacer l’emploi dans certaines tâches, qu’elle va permettre aux travailleurs de devenir plus entreprenants ou créatifs, et de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. C’est la thèse soutenue par Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee dans « Le deuxième âge de la machine » (2014). Dans ce livre, les deux auteurs annoncent une nouvelle ère de prospérité liée à l’augmentation des emplois non routiniers au détriment des emplois routiniers qui, eux, diminuent. Pour Brynjolfsonn et McAfee, il y a trois domaines dans lesquels les humains conservent un avantage sur la machine : la créativité et l’esprit d’entreprise, les relations interpersonnelles, et la dextérité. Selon ces deux auteurs, les robots sont maladroits : coiffeurs, jardiniers, plombiers, ont encore de beaux jours devant eux. L’IA est un « rehausseur de compétences pour les humains et un élixir pour l’économie grâce au boom de la productivité ». David Autor, professeur au MIT et spécialiste de l’économie du travail, défend un point de vue analogue. D’après lui, la classe moyenne américaine, vidée de ses compétences par l’automatisation et la mondialisation, pourra retrouver un avenir grâce à l’IA générative (« générative » parce qu’elle crée de nouveaux contenus et de nouvelles idées). L’IA peut aider à reconstituer cette classe moyenne en lui donnant accès à des expertises spécialisées, auparavant monopolisées par une élite d’experts. Et d’après Autor, la crainte d’une destruction d’emplois liés à l’IA est déplacée, car le monde industrialisé souffre désormais d’une pénurie de main-d’œuvre du fait de la baisse de la natalité.
Les techno-pessimistes pointent de leur côté le volet obscur de l’IA. Parmi eux, on peut citer Daron Acemoglu, l’un des trois prix Nobel 2024 (avec James Robinson et Simon Johnson). Dans le livre Pouvoir et progrès (2023), Acemoglu et Johnson passent en revue mille ans de progrès technologique, de la charrue aux caisses automatiques, à l’aune de la création d’emplois et de la diffusion des richesses. Et le constat est que les nouvelles machines peuvent avoir des conséquences très différentes, mais n’aboutissent pas forcément à un partage pour tous des richesses créées. Si le fordisme a débouché sur la prospérité générale, l’IA et ses outils prennent de nos jours plutôt le chemin du remplacement des travailleurs : « tout le monde se concentre sur l’exploitation de l’IA aux fins de réduction du coût du travail, sans se préoccuper de l’expérience immédiate des clients et du pouvoir d’achat des Américains », constatent les deux Nobel. Quant aux effets de l’IA générative sur la productivité, comme Robert Solow l’avait montré il y a plus de trente ans avec l’informatique, Acemoglu affirme que ses effets ne se voient pas encore. Selon ses calculs, seul un cinquième des tâches exercées par des employés américains est exposé aux effets de l’IA générative, et au sein de ces tâches le potentiel d’automatisation est limité à 20%. Cela s’explique par une capacité d’apprentissage limitée pour les tâches exposées. Le résultat est que les gains potentiels de croissance seront dix fois moins importants que ceux mis en avant par les techno-optimistes. Le scepticisme à l’égard de l’IA est également partagé par Daniel Cohen dans Homo numericus. D’après lui, « l’arrivée de l’IA marque une nouvelle étape fondamentale dans la société numérique, comparable sans doute, mais en sens inverse au niveau des bienfaits, à l’invention de l’imprimerie ». Et on peut ajouter à ces considérations que la question de la redistribution des richesses est également essentielle. D’après Hélène Rey, professeur à la London Business School, l’IA a des effets pervers : elle décuple la productivité des travailleurs qui l’utilisent et marginalise ceux qui peuvent être remplacés par des algorithmes. De plus, entre les pays, les innovateurs qui détiennent l’accès aux données peuvent être tentés d’en extraire des rentes : c’est déjà le cas avec les GAFAM.
Voir les notes de lecture du livre de Daron Acemoglu et Simon Johnson « Pouvoir et progrès" et celle du du livre de Grégory Verdugo « L’IA et l’emploi »
Quatrième de couverture
Inégalités, mondialisation, dette, inflation, dérèglement climatique, intelligence artificielle….
Les économistes s’opposent violemment pour décrypter, modéliser et proposer des remèdes au tourbillon actuel. Tout et son contraire se côtoient dans la prise en compte de ces sujets.
La guerre qui les divise a pour cadre le MIT, Harvard, Oxford, la Bocconi, l’Ecole d’économie de Paris, celle de Toulouse ainsi que les think tanks, les institutions financières internationales et la scène médiatique. Prix Nobel, dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, de la Fed et de la BCE, universitaires du monde entier et penseurs de tous bords en sont les acteurs.
Les auteurs passent en revue leurs grands débats économiques en ciblant leurs thèses qui se confrontent, leurs erreurs d’analyse et leurs imprécisions. Ils dressent aussi les portraits des principaux protagonistes de ces face-à-face- D.Cohen, T. Piketty, O. Blanchard, M. Aglietta, J. Stiglitz, L. Summers, J. Milei, P. Aghion, D. Acemoglu- et de leurs maîtres à penser, de Keynes à Schumpeter.
Une enquête vivante et éclairante, au cœur des idées des hommes et des femmes qui font ou défont l’économie d’aujourd’hui.
Les auteurs
Pierre-Henri de Menthon a effectué l’essentiel de sa carrière dans la presse économique (La Tribune, Option Finance, Le Nouvel Economiste) avant de diriger la rédaction de Challenges.
Bruna Basini, d’abord avocate au barreau de Paris et de New-York, est devenue journaliste et travaille pour Le Nouvel Economiste, L’Expansion, puis au Journal du Dimanche où elle couvre le monde des affaires et les questions macroéconomiques.
Questions pour vérifier l’acquis et vous entraîner sur les points abordés
1- La démocratie est-elle nécessaire à la croissance économique ?
2- Comment expliquer le « déclin démocratique » dans certains pays du monde ?
3- Les dépenses militaires sont-elles improductives ?
4- Qu’est-ce que le « keynésianisme militaire » ?
5- L’intelligence artificielle est-elle une menace pour l’emploi et la répartition des revenus ?




