Mots-clés : Capitalisme, état stationnaire.
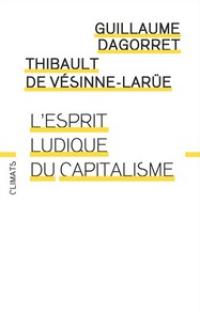
Résumé
En dressant une analogie avec le jeu vidéo, les auteurs de cet ouvrage exposent l’idée selon laquelle la menace principale qui pèse sur le capitalisme n’est pas l’augmentation des inégalités, la crise climatique, ou encore la perspective de l’extinction des ressources naturelles, mais plutôt la fin de la croissance économique.
L’ouvrage
L’essai de Guillaume Dagorret et Thibault de Vésinne-Larüe se propose d’identifier le capitalisme à un jeu, avec une interprétation particulière du jeu qui est celle du jeu vidéo. D’après les auteurs, le jeu n’est pas une activité avec des règles et un but, mais avant tout une boucle itérative d’actions simples (appelée le « Core gameplay »), qui confère un sentiment de progression continue via l’accumulation d’un indicateur quantitatif (appelé aussi « Meta gameplay »).
Dans le capitalisme, l’échange répété forme le Core gameplay, tandis que l’objectif d’accroître indéfiniment le « score d’argent » constitue le Meta gameplay. Et cet esprit ludique du capitalisme amène à identifier trois enseignements essentiels sur son fonctionnement.
Premièrement, l’interrogation sur le sens du capitalisme appelle la même réponse que celle qui porte sur les jeux vidéo : le jeu en lui-même crée du sens, et ses acteurs, obnubilés par le Meta gameplay, sont motivés par sa courbe de progression ; à l’inverse, ceux qui ne s’intéressent pas ou ne s’engagent pas dans le capitalisme ne peuvent pas en voir le sens. Donc, toujours d’après les auteurs, le capitalisme aura du sens tant que la majorité des joueurs qui y participent seront motivés par la dynamique de progression que ce système économique propose.
Deuxièmement, et ce point est intimement lié à ce qui précède, le capitalisme ne s’arrêtera pas du fait de la dénonciation de la pauvreté, de la progression forte des inégalités, ou encore du réchauffement climatique (aucun jeu ne s’arrête parce qu’il y a des perdants). Le capitalisme se délitera lorsque la classe moyenne active se rendra compte que, malgré ses efforts, sa progression stagne ou régresse par rapport aux générations précédentes. Ce phénomène est déjà bien engagé pour une grande partie de la génération d’aujourd’hui. Pour que le capitalisme puisse perdurer, il faut qu’il progresse : il ne pourra se maintenir que s’il parvient à réintroduire cette dimension de progression quantitative, individuelle et intergénérationnelle.
Troisièmement, puisque le jeu est partout, qu’il est la forme la plus fondamentale de nos interactions sociales, et qu’il est tout sauf une activité légère et insouciante, s’il venait à s’éteindre, on peut penser avec Schumpeter que « des activités extra-économiques attireraient les meilleurs experts et fourniraient des occasions d’aventures » (Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942). Selon Dagonnet et de Vesinne-Larüe, deux jeux pourraient succéder au capitalisme : le jeu de la renommée, dans lequel les acteurs ne cherchent pas à accumuler la richesse, mais plutôt la réputation sociale ; et le jeu de la guerre, à l’image des mercantilistes qui voyaient le commerce international comme un outil au service de la puissance militaire du roi.
Au total, le but de cet essai est de montrer que le jeu est et restera le moteur premier des sociétés humaines. Peu importe la nature du jeu ; ce qui compte, c’est de pouvoir progresser, faire mieux, pour toujours porter le jeu à un niveau plus élevé.
Voir la notion « Capitalisme »
I- Les jeux de l’échange
A la différence de Roger Caillois qui écrivait du jeu qu’il est « une activité improductive, ne créant ni biens, ni richesses » (Les jeux et les hommes, 1958), la thèse du livre s’appuie sur une vision particulière du jeu qui est que celui-ci n’est pas par essence une activité divertissante (mais plutôt une activité immersive ou une « violente occupation »), qu’il n’est pas libre (le sentiment de libre-arbitre s’efface rapidement dans le jeu), et qu’il n’est pas forcément séparé de la réalité (l’esprit ludique du jeu disparaît quand le jeu perdure).
Dans ces conditions, on peut considérer que le capitalisme est un jeu obéissant, comme tous les jeux, à la formule Core + Meta gameplay. Quels sont les Core et Meta gameplay du capitalisme ?
Le Core gameplay du capitalisme (ensemble d’actions que nous répétons inlassablement) est l’échange. L’échange porte sur les biens, les services, les promesses, les titres, les inventions, …. Nous passons nos journées à échanger, et ces échanges sont autant de « coups » autorisés par le Core gameplay du capitalisme. D’après les auteurs du livre, le capitalisme est cette société où tous les individus échangent environ une vingtaine de fois par jour, explicitement ou implicitement. Il est difficile de savoir quand ce seuil a été franchi précisément dans l’histoire, mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a quelques siècles, personne n’échangeait aussi fréquemment. La répétition continuelle d’échanges à haute fréquence est la vraie spécificité anthropologique du capitalisme.
Et en ce qui concerne le Meta gameplay du capitalisme, donc le système d’incitations qui nous pousse à répéter continuellement ces échanges via une logique de progression infinie, c’est évidemment l’argent. Ou plus précisément l’accumulation d’argent : ce qui incite les joueurs à s’engager continuellement dans l’échange est l’objectif d’accumuler toujours plus d’argent. Cette logique d’enrichissement continuel s’applique aussi bien au niveau individuel (richesse personnelle) qu’au niveau collectif (augmentation du PIB). Tout comme n’importe quel jeu vidéo, ce Meta gameplay repose sur une structure de points et de niveaux à atteindre, que ce soit pour un individu la recherche du prochain poste et de l’augmentation salariale qui l’accompagne, ou pour un pays le prochain stade de développement économique. Au niveau des individus, la perspective de la satisfaction des besoins est toujours repoussée à demain, et ceci vaut aussi bien pour les plus riches que pour les classes moyennes et populaires. Si les moins favorisés ne se satisfont jamais de ce qu’ils ont malgré l’augmentation de leur pouvoir d’achat dans le temps, il en est de même pour les millionnaires qui déclaraient par exemple en novembre 2014 dans une enquête du journal Le Monde qu’ils souhaiteraient le double de ce qu’ils possèdent déjà pour se sentir « vraiment à l’aise ».
L’échange dans la perspective de l’enrichissement : tel est le Core et le Meta gameplay du capitalisme, qui répond point par point à la formule la plus générale du jeu. Un Core gameplay simple, intuitif et répétitif, animé par un Meta gameplay immersif. Cette vision du capitalisme comme un état d’esprit se retrouve chez certains grands auteurs. Fernand Braudel, tout d’abord, qui a intitulé « jeux de l’échange » le volet de son ouvrage majeur consacré au capitalisme (Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Les jeux de l’échange, 1967). Frantz Kafka et Max Weber ensuite, qui, dans des registres différents, affirmaient que « le capitalisme est à la fois un état du monde et un état de l’âme » (expression de Kafka, alors que Weber insistait de son côté sur le rôle de l « ethos » dans la dynamique du capitalisme. Et enfin Marx lui-même dans Le Capital (1867)qui énonce la thèse selon laquelle la répétition continuelle de l’échange n’a d’autre but que l’accumulation : « Dans l’achat pour la vente [….], le commencement et la fin sont une seule et même chose, argent, valeur d’échange, et cette identité de ces deux termes extrêmes fait que le mouvement n’a pas de fin ».
Voir la notion « Capitalisme et économie de marché »
II- La perspective de la fin du capitalisme
Dans les jeux, de manière générale, c’est le Meta gameplay qui, en générant une progression constante, rend le jeu immersif et addictif. Si cette progression faiblit pour la majorité des joueurs, cette immersion disparaît, et le jeu meurt.
Quand on évoque la fin du capitalisme, on retient souvent deux éléments : l’augmentation des inégalités et le réchauffement climatique. Selon Dagonnet et de Vesinne-Larüe, le capitalisme est menacé avant tout par un Meta gameplay défectueux. En d’autres termes, le capitalisme est miné par une pathologie que les économistes désignent généralement sous le nom de « stagnation séculaire », et dont le symptôme le plus évident est le ralentissement des gains de productivité observé sur plusieurs décennies. En effet, loin d’être une statistique parmi d’autres, la productivité est la statistique de référence du capitalisme. Lorsque la productivité stagne ou régresse, les rouages du capitalisme se grippent : les profits et les investissements des entreprises baissent, les salaires et le pouvoir d’achat chutent, entraînant une baisse du niveau de vie des ménages. C’est ce constat qui a inspiré à l’économiste américain Paul Krugman sa célèbre remarque : « la productivité n’est pas tout, mais sur le long terme, elle est presque tout ».
Le débat fait rage parmi les économistes pour expliquer cette stagnation séculaire : faiblesse des gains de productivité dans les économies de services, innovations actuelles qui n’ont pas le même impact sur la productivité que celles du passé, baisse de la concurrence entre les entreprises (illustrée par la présence des grandes entreprises technologiques qui dominent le marché dans certains secteurs comme Amazon, Google et Facebook), faiblesse de la consommation des ménages suite à la crise financière de 2008 suivie de la crise de la dette à partir de 2010, systèmes éducatifs peu performants qui créent des décalages entre les compétences enseignées dans les institutions éducatives et celles requises sur le marché du travail, vieillissement de la population qui modifie les modèles de consommation. Mais ce qui compte ici c’est la conséquence principale de cette baisse tendancielle de la productivité et qui réside dans le blocage de la mobilité intergénérationnelle.
Dans la plupart des pays avancés, la mobilité intergénérationnelle, qu’elle soit absolue (proportion des individus dont les revenus dépassent ceux de leurs parents au même âge) ou relative (probabilité de connaître une mobilité sociale d’une génération à une autre), s’est significativement affaiblie depuis la fin des années 1980. En ce qui concerne la mobilité absolue, l’économiste Raj Chetty a révélé que 90% des Américains nés en 1940 vivaient mieux que leurs parents, contre seulement 50% pour ceux nés après 1980. Au niveau de la mobilité relative, elle a également diminué dans la plupart des nations avancées depuis la même période. Tout se passe comme si le capitalisme s’était figé, et que la promesse d’échapper à une société de classes avait été rompue.
Le méta-jeu du capitalisme est grippé. Le jeu est désormais « bloqué », en limitant les chances de chacun de surpasser les générations précédentes, et en augmentant la probabilité de rester coincé dans la même position économique que ses parents. Désormais, gagner au jeu du capitalisme dépend davantage des résultats de nos parents et grands-parents que de nos propres efforts. Les conséquences de ce phénomène sont déjà palpables dans les enquêtes d’opinion. De plus en plus de Français déclarent que le travail n’est plus quelque chose de « très important » dans leur vie. D’autres montrent un sentiment d’apathie vis-à-vis du travail. Un symptôme de cette mutation est le phénomène du « quiet quitting », qui consiste à se filmer en position de fournir le strict minimum au travail tout en évitant le licenciement. Tous ces symptômes signifient une forme de résignation tacite, qui accompagne les « fins de jeux ». Le jeu ne persiste que par habitude, mais les participants en sont déjà sortis.
Cette situation est inédite depuis le début du capitalisme. Elle rejoint la mentalité précapitaliste, telle qu’elle a pu être décrite par Weber dans « L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme » (1905). Dans cet ouvrage, Weber décrit l’esprit « traditionnaliste », c’est-à-dire non influencé par le désir d’enrichissement continu. Lorsque les premiers capitalistes ont tenté d’introduire le « salaire aux pièces », système de rémunération fondé sur la quantité produite, cette stratégie a d’abord échoué face à l’indifférence des ouvriers : le gain supplémentaire attirait moins que la réduction du travail. Le salarié ne se demandait pas combien il pourrait gagner par jour en fournissant le maximum de travail, mais quel travail il devait fournir pour couvrir ses besoins limités. Le résultat est que plutôt qu’une hausse de la productivité et des profits pour le capitalisme, on assistait à une réduction du temps de travail pour le salarié. D’après Dugonnet et de Vesinne-Larüe, nous serions maintenant revenus à la case départ. La quête de l’enrichissement n’existe plus, et si cette tendance persiste, les joueurs finiront par se lasser de ce jeu, et chercheront d’autres horizons ludiques.
Voir la notion « état stationnaire » et sa version vidéo
III- Vers l’apparition de nouveaux jeux ?
Considérer le capitalisme comme un jeu permet d’imaginer trois scénarios quant au futur.
Le premier scénario est celui où le capitalisme retrouverait sa vitalité et resterait en conséquence notre principal jeu. Comment revitaliser le capitalisme pour retrouver la croissance ?
Plusieurs solutions peuvent être envisagées, comme l’innovation technologique, les politiques publiques d’investissement, ou encore les réformes structurelles. On insistera ici sur l’innovation technologique, qui il est vrai a permis au capitalisme d’accomplir des bonds importants en termes de productivité, à l’image de la machine à vapeur ou de l’électricité qui se sont accompagnées de hausses de productivité annuelle de l’ordre de 3 à 4%. Tous les espoirs se concentrent aujourd’hui sur l’intelligence artificielle (IA). En automatisant des tâches complexes et en améliorant la prise de décision grâce à l’analyse de données, l’IA pourrait potentiellement générer des gains de productivité similaires à ceux des révolutions industrielles précédentes. Si les technologies de l’IA sont déployées à grande échelle, elles peuvent représenter une avancée majeure en réduisant le coût de nombreux produits et services (dans les secteurs de la santé, de l’enseignement, de la finance ou encore de la logistique), redonnant ainsi du pouvoir d’achat à la plupart d’entre nous, ce qui pourrait relancer la croissance économique. C’est ce qu’expliquent des économistes comme Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson (The Second Machine Age, 2014). Néanmoins, tous les économistes ne partagent pas cet optimisme. Daron Acemoglu (prix Nobel d’économie 2024, avec Simon Johnson et James A. Robinson) pense par exemple que les effets macroéconomiques de l’IA seront probablement modestes, en raison de la difficulté à automatiser beaucoup de tâches complexes.
Si le capitalisme devait s’effondrer en tant que jeu, un deuxième scénario est envisageable selon les auteurs, s’appuyant sur la renaissance de jeux anciens, avec en premier lieu le jeu de la guerre. Si on examine la guerre sous la perspective du jeu, il n’est pas difficile d’y discerner un Core et un Meta gameplay très spécifiques. Le Core gameplay de la guerre est l’envie de détruire, principalement des vies humaines et des biens matériels. Le Meta gameplay de la guerre correspond à l’objectif de conquérir, principalement du territoire ou de l’influence. Cette thèse n’est pas nouvelle, puisque la guerre et le jeu ont été maintes fois associés dans l’histoire, ne serait-ce que par le grand théoricien de la guerre Carl Von Clausewitz, qui affirmait que la guerre est un « jeu sérieux ». Joseph Schumpeter, à son tour, expliquait que « dans la vie des rois, la guerre occupait le même rôle que les sports et les jeux dans la vie contemporaine ». Plus récemment, le philosophe Michel Foucault a développé également une analyse selon laquelle la guerre serait un jeu total qui a précédé le capitalisme. Selon lui, la transition de l’Allemagne dans la période de l’après-1945 s’explique parce que celle-ci, ne pouvant plus fonder sa légitimité sur la guerre, a choisi le capitalisme comme socle de sa légitimité politique. A partir de là, son succès en tant que nation ne repose plus sur le territoire qu’elle peut contrôler ou annexer, mais sur ses progrès économiques.
Si l’enrayement du Meta gameplay capitaliste se confirmait, un troisième et dernier scénario est à envisager pour nos auteurs, et il s’agit d’une activité qui comporte un Core et un Meta gameplay distinctifs, et qui mobilise déjà une communauté de joueurs et de spectateurs. Ce jeu très particulier peut être qualifié de « jeu de la renommée ». Dans ce jeu, le Core gameplay consiste à produire et publier des expressions de soi (sous la forme de photos, vidéos ou déclarations), tandis que le Meta gameplay consiste à obtenir toujours plus d’approbation sociale (sous la forme de likes, de dislikes ou de commentaires). L’émergence potentielle d’une société dominée par le jeu de la renommée, où le Meta gameplay n’est plus l’accumulation d’argent, mais de réputation ou de reconnaissance, pourrait transformer radicalement nos sociétés. Au lieu de la richesse matérielle, les individus aspireraient à une accumulation de likes, d’approbations et d’évaluations positives. Dans son ouvrage La société du spectacle (1967), le philosophe Guy Debord imaginait déjà les contours d’une telle société qui se présenterait comme une « immense accumulation de spectacles ».
Voir la note de lecture du livre de Daron Acemoglu et Simon Johnson « Pouvoir et progrès, technologie et prospérité : notre combat millénaire »
Quatrième de couverture
Et si le capitalisme s’effondrait non pas sous le poids des inégalités ou de la crise climatique, mais faute de progression ? Autrement dit, si sa véritable fragilité résidait non dans un excès, mais dans un défaut de croissance ? C’est ce qu’affirme cet essai en proposant une hypothèse originale : le capitalisme s’organise comme un jeu vidéo réussi. Il repose sur un Core gameplay, l’échange, et un Meta gameplay, l’enrichissement. Ces deux composantes produisent une expérience immersive, structurée autour d’une courbe de progression.
Dans la logique du jeu, le principal risque n’est pas qu’il devienne addictif… Mais qu’il lasse ses joueurs jusqu’à finir par les perdre. Le sentiment de progression individuelle et collective disparaît, comme c’est le cas aujourd’hui dans les économies avancées. Veut-on encore jouer lorsque le jeu ne permet plus de progresser ?
S’appuyant sur les enseignements de l’industrie du jeu vidéo et sur ceux des théories économiques, Guillaume Dagorret et Thibault de Vésinne-Larüe soulèvent une question audacieuse : si le capitalisme ne permet plus de progresser, peut-il être supplanté par d’autres jeux, et quels seront-ils ?
Les auteurs
Guillaume Dagorret est diplômé de HEC Paris, où il enseigne. Il est directeur de projet dans un cabinet de conseil international. Thibault de Vésinne-Larüe est vice-président et responsable de la production de jeux chez Voodoo, leader mondial de l’industrie du jeu vidéo mobile. Il est diplômé de Centrale Paris.
Questions pour vérifier l’acquis et vous entraîner sur les points abordés
1- Pourquoi peut-on assimiler le capitalisme à un jeu ?
2- Quels sont les différents éléments avancés pour expliquer la stagnation séculaire ?
3- Pourquoi la stagnation séculaire menace-t-elle l’existence même du capitalisme ?
4- Peut-on considérer la guerre comme un jeu ?
5- Quel est le nouveau « jeu » qui peut remplacer le capitalisme selon les auteurs ?



