Mots-clés : Dette, Immigration, Inégalités.
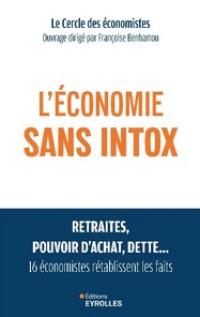
Résumé :
Au moment où les grands sujets économiques et sociaux font l’objet d’opinions diverses non étayées et bien souvent contradictoires, il est important d’aider les citoyens à faire des « choix éclairés ». C’est ce que propose ce livre avec l’ambition de revenir avant tout aux faits, en s’appuyant sur les travaux de scientifiques reconnus, tous membres du Cercle des économistes.
L’ouvrage :
Comment aider les citoyens à faire des choix éclairés et comprendre le monde qui se dessine et se transforme sous nos yeux ? Cette question est cruciale aujourd’hui. En effet, dès lors qu’il s’agit de réfléchir aux grandes questions économiques et sociales, le raisonnement rationnel s’efface bien souvent devant l’affirmation de choix idéologiques qui n’entretiennent qu’un rapport limité avec les faits. Et ceci est particulièrement vrai à l’heure des fake news, des données fantaisistes au service d’opinions tranchées, et des réseaux sociaux qui émettent des pseudo-conversations.
Dès l’introduction de l’ouvrage, Françoise Benhamou nous rappelle la célèbre citation d’Albert Camus selon laquelle « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». C’est la raison pour laquelle ce livre propose de revenir aux faits, en s’appuyant sur les travaux académiques d’experts économistes reconnus. Certes, on ne peut ignorer que le « fait brut » n’existe pas. Les faits dont on parle sont toujours produits, sont issus d’observations et supposent des conventions. Mais il n’en reste pas moins que la référence à des éléments objectifs, au-delà de l’opinion, permet de fonder des analyses et de se départir des idées fausses. Il ne s’agit pas de « décider à la place du décideur », de remplacer « le gouvernement des hommes par l’administration des choses », mais d’informer sur des bases objectives avant de proposer ou d’adhérer à des mesures de politique économique et sociale pertinentes.
C’est à cet exercice que se sont prêtés seize économistes membres du Cercle des économistes, tous soucieux d’exposer les faits avant d’envisager des mesures de politique économique et sociale sur les questions de l’environnement, de la fragmentation de l’économie mondiale, de l’alimentation, des comptes extérieurs de la France, des enjeux de la réindustrialisation du pays, des retraites, du rapport au travail, du taux d’emploi, des effets de l’intelligence artificielle, du niveau des inégalités, de l’immigration, de la dette, de l’économie des médias, des dépenses culturelles, et pour terminer du bien-être.
Evidemment, dans les lignes qui suivent, il n’était pas possible d’aborder tous ces sujets. On retiendra trois questions cruciales dans le débat politiquer actuel que traverse la société française, à savoir celles de l’immigration, de la dette, et des inégalités.
Voir la note de lecture du livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg « Le négationnisme économique »
I- L’immigration
En matière d’immigration, de nombreux Français adhèrent sans nuance à l’idée qu’ « il y a trop d’immigrés » ou que « les immigrés prennent le travail des Français ». Hippolyte d’Albis se propose de traiter l’immigration pour motif de travail en France sous l’angle de son ampleur d’abord, de ses effets économiques ensuite.
Concernant l’ampleur du phénomène d’abord, il faut d’abord rappeler deux faits, à savoir que l’Etat ne participe plus directement au recrutement de travailleurs étrangers depuis 1974, et que la construction européenne implique une adhésion à un espace de libre circulation des personnes (avec des flux annuels relativement faibles, de l’ordre de 100000 personnes, ce qui vient contredire tous ceux qui craignent « l’appel d’air » engendré par l’ouverture des frontières). Ce deuxième fait a pour conséquence que la régulation du flux d’immigration de travail ne concerne que les ressortissants des pays tiers, qui sont soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour pour résider et travailler légalement en France. On peut ventiler cette immigration extra-européenne en trois catégories : l’immigration des personnes destinées à occuper des postes hautement qualifiés, l’immigration régulière des personnes destinées à occuper des postes moins qualifiés, et la régularisation administrative des personnes en situation irrégulière. Dans tous les cas, l’immigration n’est ni totalement choisie, ni réellement subie par l’Etat. La sélection et le recrutement sont réalisés par des employeurs, et le droit de séjour relève d’une décision discrétionnaire des autorités administratives compétentes.
Avec Ekrame Boubtane, Hippolyte d’Albis a reconstitué l’évolution de l’immigration professionnelle de ces trois catégories depuis 2000. Au cours de la période allant de 2000 à 2021, en moyenne annuelle, ce sont un peu moins de 13400 personnes qui ont obtenu un titre de séjour pour motif professionnel (à comparer aux 750000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail). Quand on examine les trois catégories précitées, on observe que l’immigration hautement qualifiée reste modeste (6500 personnes en 2021), que l’immigration régulière des personnes moins qualifiées représente en moyenne 8100 personnes par an, et que les régulations, si elles augmentent au fil du temps, restent cependant à un niveau modeste (en 2021, elles touchent 12700 personnes, soit 41% de l’immigration professionnelle).
Au niveau maintenant des effets économiques de l’immigration, la crainte est double : elle touche à la fois les travailleurs qualifiés des secteurs ouverts au recrutement d’étrangers (qui s’attendent à une baisse de salaire du fait d’une augmentation de l’offre de travail) et les travailleurs les moins qualifiés rémunérés aux alentours du SMIC (puisque l’immigration peut engendrer un excédent de demandeurs d’emploi, et donc du chômage). Mais au rebours de ce raisonnement simpliste basé sur l’offre et la demande de travail, on peut dire que l’immigration a peu d’impact sur le chômage et sur les salaires, et cela pour trois raisons. La première raison est que les immigrés sont discriminés sur le marché du travail, et qu’en conséquence, ils ne peuvent pas concurrencer celui ou celle qui n’est pas victime de discrimination. A compétence égale, les immigrés ne trouvent un emploi que là où les nationaux font défaut. La deuxième raison est que les immigrés sont très majoritairement concentrés dans certains secteurs d’activité (employés de maison, agents de gardiennage, ouvriers non qualifiés du bâtiment, cuisiniers,… ), dans lesquels les salaires sont plus faibles que la moyenne. La troisième et dernière raison est que du fait de leur jeunesse, les immigrés apportent une contribution positive à l’économie. Ils exercent en effet un effet positif sur le taux d’emploi qui affecte l’équilibre des finances publiques, et par là-même le niveau de vie de la population des Français.
En conclusion, l’analyse des faits montre que l’immigration de travail est faible en France et qu’elle ne détériore par la situation économique des travailleurs nationaux.
Voir la note de lecture du livre de François Héran « L’immigration : le grand déni »
II- La dette
La dette publique est un objet politique par excellence. Il est vrai qu’elle a augmenté continûment depuis 50 ans, passant de 14,5% du PIB en 1974 à 114% environ en 2024. Dès lors, une des questions récurrentes dans le débat politique est de savoir à qui imputer cette dette. Est-elle le fait de gouvernements de droite ou de gauche ? D’après le sens commun, la gauche incarne plutôt la générosité sociale, et donc l’augmentation des dépenses publiques, et la droite l’austérité et la recherche de la réduction des dépenses, et donc par là-même à terme de la dette.
Or, selon Xavier Ragot, l’histoire de la dette publique en France révèle que son augmentation est le fruit des politiques menées par la droite, le centre et la gauche, et cela avec une certaine constance depuis 50 ans. Mais on constate aussi que sur cette période les gouvernements de droite ont davantage contribué à l’augmentation de la dette publique. En moyenne, celle-ci a progressé de 2,2 points de PIB par an durant les vingt-quatre années où la droite était au pouvoir, contre 1,6 point par an sous les gouvernements de gauche, qui ont dirigé le pays pendant dix-neuf ans environ. Dans ce calcul, Xavier Ragot considère la présidence d’Emmanuel Macron comme une troisième catégorie. La dette publique est passée de 98,4% du PIB à 114% aujourd’hui, soit une hausse de 2,2 points de PIB par an depuis 2017.
Les comparaisons internationales disponibles semblent aller dans le même sens que le cas français, comme le montre l’étude réalisée par Andreas Müller, Kjetil Storesletten et Fabrizio Zilibotti (« The Political Color of Fiscal Responsibiliy », Journal of the Europeen Economic Association, 2016). En Suède, la dette publique rapportée au PIB a augmenté pendant la période du gouvernement conservateur de Falldin en 1979 et Bildt en 1991, et a été réduite par les deux gouvernements socio-démocrates suivants. Aux Etats-Unis, on observe la même moyenne sur une longue période : de 1950 à 2013, les gouvernements républicains ont augmenté la dette publique de deux points de PIB de plus par an en moyenne par rapport aux gouvernements démocrates. Et de manière plus générale dans l’ensemble des pays de l’OCDE pendant la période 1950-2007, un basculement politique de gauche à droite a toujours augmenté la dette publique.
Comment expliquer ce paradoxe ? D’après les auteurs de l’étude précitée, les électeurs de gauche accordent une grande importance à l’intervention étatique, que ce soit pour réduire les inégalités, produire des biens publics, assurer une éducation et une santé gratuites, etc. Dans ces conditions, le financement de l’Etat est très important pour eux, car il est la condition de la vigueur de cette intervention étatique. En revanche, les électeurs de droite n’attendent pas grand-chose de l’Etat et préfèrent retirer leur satisfaction de la consommation de biens et services marchands. De ce fait, ils envisagent sans inquiétude la déstabilisation des finances publiques.
Le cas américain illustre bien cette explication. Au début des années 1980, la stratégie des conservateurs américains pour réduire l’intervention de l’Etat a été une politique volontariste de réduction des impôts. D’après Milton Friedman, les déficits qui en résultent constituent une restriction efficace à la propension à dépenser du pouvoir politique. Mais compte-tenu de la perception de l’échec de cette stratégie d’ « affamer la bête » par les électeurs républicains, la politique actuelle du gouvernement Trump, adossée à une administration, le Department of Economic Efficiency (DOGE), vise à réduire plutôt rapidement et avec une grande ampleur les dépenses publiques, et ceci dans la perspective de diminuer la dette publique américaine.
Le cas de la France et de l’Europe est très différent, puisque l’Etat social y est plus développé, et que les populations montrent un grand attachement aux politiques de redistribution : les Européens sont globalement attachés aux transferts induits par l’Etat-providence en matière de santé, d’éducation, de retraite par répartition, etc. Il est donc probable que l’Europe ne connaîtra pas l’équivalent du mouvement libertarien américain actuel. Cela dit, il n’en reste pas moins qu’il faudra réussir à placer la dette publique sur une trajectoire décroissante (et en France tout particulièrement), en espérant que cette obligation soit comprise et partagée par la population et ses représentants politiques, avec un consensus sur les politiques économiques et sociales nécessaires pour y parvenir.
Voir la notion «dette publique »
III- Les inégalités
On pense généralement que les inégalités explosent, et que la solution au problème consiste à puiser dans la deep pocket des quelques bénéficiaires de ces inégalités. Pour beaucoup de nos concitoyens, il existe une disposition simple à mettre en œuvre pour remédier aux inégalités, consistant à adopter un impôt sur la fortune (ISF) qui pourrait se décliner selon différentes modalités : un ISF pour la transition climatique, un ISF sécuritaire pour le réarmement de l’Europe, un ISF vieillesse pour combler le déficit des retraites, un ISF solidaire pour le logement d’urgence, etc.
Mais de quoi parlons-nous quand on dit que les inégalités explosent ? Philippe Trainar nous rappelle que, alors que le débat public se disperse, les économistes ont entrepris au cours du dernier quart de siècle une analyse approfondie des dimensions pertinentes des inégalités. Et ces analyses conduisent à distinguer les zones géographiques, les revenus, les patrimoines, et aussi les revenus avant impôts, après impôts mais avant prestations sociales, les revenus nets après impôts et prestations sociales, les revenus distribués par rapport aux revenus non distribués. En toute logique, il est bon également de suivre des cohortes de ménages bien identifiés afin de savoir comment évolue leur situation en fonction de leur situation de départ. Sur toutes ces dimensions, les économistes apportent des informations précieuses. Quels enseignements peut-on retenir de ces analyses pour le cas français ?
Pour la France donc, le constat est celui d’une baisse des inégalités de revenu avant impôt depuis la guerre jusqu’au début des années 1980, puis d’une remontée suivie d’une stabilisation à partir du début des années 2000. Le coefficient de Gini a ainsi diminué de 0,48 en 1950 à 0,41 en 1980, pour remonter à 0,45 en 2000 et 0,46 en 2003.
Quant aux inégalités après redistribution, elles seraient restées stables depuis le début des années 1980. Après redistribution fiscale et sociale, elles auraient légèrement diminué.
Si on suit maintenant le niveau de vie de cohortes homogènes (après redistribution fiscale et sociale), en France, comme d’ailleurs aux Etats-Unis, on observe un « retour à la moyenne », qui correspond à une tendance des inégalités à diminuer dans le temps.
Et enfin concernant les inégalités de patrimoine, le constat est celui d’une hausse des inégalités depuis le milieu des années 1980, le coefficient de Gini croissant de 0,41 en 1980 à 0,46 en 2022. Si ce constat fait consensus, il doit cependant être nuancé en prenant en compte le patrimoine « retraite » des salariés auprès des organismes de Sécurité sociale, qui n’est pas intégré aux statistiques d’inégalités patrimoniales alors qu’il se substitue à de l’épargne de cycle de vie. Ce facteur « retraite » joue un rôle « égalisateur » susceptible de réduire significativement l’indice de Gini, sachant que les engagements des régimes obligatoires de retraite sont estimés à plus de 10000 milliards d’euros et représentent l’équivalent de plus de 70% du patrimoine officiel des Français.
Pour conclure, il est évident que la réalité des inégalités et de leur évolution ne saurait se résumer au mot « explosion ». Les seules inégalités dont l’augmentation est indiscutable sont les inégalités de patrimoine, avec la nuance que la non-prise en compte des droits à la retraite impose une grande prudence dans les affirmations. En tout cas, selon Philippe Trainar, les statistiques dont on dispose sur les inégalités et leur évolution ne permettent pas de justifier l’existence de politiques plus affirmées de lutte contre les inégalités et de redistribution. Dès lors, quels peuvent être les fondements de ces politiques ? Toujours selon Philippe Trainar, il faut les rechercher du côté de la transparence sur les objectifs ultimes de toute lutte contre les inégalités, ou à l’inverse de toute défense des inégalités, de façon à mieux distinguer ce qui relève du bilan statistique et économique objectif de ce qui ressort des idéaux politiques ou éthiques.
Voir la note de lecture du livre de Louis Maurin « Déchiffrer la société française »
Quatrième de couverture
Fake news, déclarations approximatives ou mensongères, manipulation des données…. Le domaine de l’économie n’échappe pas à ces maladies de nos temps modernes. Dès lors, comment trouver de vraies réponses ? La question, cruciale pour l’avenir de nos démocraties, traverse le monde de la recherche comme celui des décideurs publics et privés. Elle interpelle le citoyen qui doit faire des choix éclairés et comprendre le monde qui se dessine et se transforme sous nos yeux.
Travaille-t-on trop peu en France ? Quels sont les vrais coûts de l’immigration ? Donne-t-on trop d’argent à la culture ? … Seize économistes, tous membres du Cercle des économistes, proposent de revenir aux faits, d’exposer les données et d’alimenter le débat à une période où les invectives se substituent trop souvent à la discussion sereine et sérieuse, respectueuse des points de vue et des choix de politique publique de chacun.
Les auteurs
Françoise Benhamou est présidente du Cercle des économistes. Elle est professeure émérite d’Economie à l’université Sorbonne-Paris-Nord et enseigne à Sciences Po Paris. Elle est notamment l’autrice de L’économie de la culture aux éditions de La Découverte.
Avec les contributions de : Hippolyte d’Albis, Patrick Artus, Françoise Benhamou, Christian de Boissieu, Stéphane Carcillo, Patrice Geoffron, Pierre Jacquet, Jean-Hervé Lorenzi, Olivier Pastré, Anne Perrot, Xavier Ragot, Christian Saint-Etienne, Katheline Schubert, Claudia Senik, Akiko Suwwa-Eisemann, Philippe Trainar.
Questions pour vérifier l’acquis et vous entraîner sur les points abordés :
1. L’immigration détériore-t-elle la situation économique des travailleurs nationaux ?
2. Comment les Républicains américains envisagent-ils de réduire l’intervention de l’Etat depuis les années 1980 ?
3. La stratégie « libertarienne » américaine de réduction de la dette publique est-elle transposable en Europe ?
4. Peut-on dire que les inégalités explosent en France aujourd’hui ?
5. Comment peut-on justifier l’existence de politiques de lutte contre les inégalités ?



