Résumé
Harold Levrel est professeur d’économie écologique à AgroParisTech, Cired ; Antoine Missemer est chercheur en économie au CNRS, Cired. Ils ont publié en février 2023 l’ouvrage intitulé « L’économie face à la nature », qui constitue un appel urgent à une transformation radicale de nos économies pour enrayer la 6ème extinction des espèces vivantes à laquelle nous assistons actuellement. Ils appuient leurs propos sur une très large perspective historique concernant chacune des cinq parties de l’ouvrage, qui décrivent autant de leviers pour la transformation écologique de nos systèmes socio-économiques.
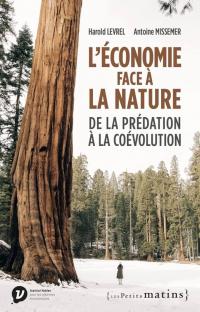
Voir les versions en PDF
Lire la notion du Lexique : Développement durable
L'ouvrage
Il s’agit (1) d’encastrer l’économie dans les dynamiques naturelles, (2) de reconnaître la dette écologique des systèmes économiques, (3) de nourrir l’être humain sans détruire les écosystèmes, (4) d’apprendre à vivre avec la diversité sauvage et (5) de transformer le contrat social en un contrat naturel. L’enjeu est de redéfinir notre rapport avec la nature pour faire émerger une économie de la coévolution, qui prendrait le pas sur l’économie de la production, qui a elle-même succédé à l’économie de la prédation. La coévolution est définie comme une « économie où les interdépendances entre activités humaines et dynamiques naturelles sont placées au cœur des modes de production et de consommation, où les êtres humains agissent par et pour le vivant en sélectionnant les innovations institutionnelles, techniques ou organisationnelles les plus adaptées à cet objectif ». Une telle transformation écologique de l’économie revient à « conditionner tout choix économique au respect de contraintes écologiques ». La cohabitation entre humains et non-humains devient alors la priorité.
Nous pensons, en lisant le très stimulant livre de Levrel et Missemer, aux nombreux écrits de Jean Giono sur la nécessité de respecter la nature. En 1938, Giono publiait une « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » (Editions Héros-Limite, 2013) dans laquelle il comparait les pêches données par quatre pêchers plantés à Ongles, « derrière le mur de l’étable à cochons », et celles produites en plaine, dans des conditions très douces et favorables aux maladies. Citons-le : « Tout le monde peut se payer des pêches à deux francs cinquante le kilo, mais la vérité c’est que ça n’a plus de pêche que le nom. J’aime mieux ne pas en manger que de manger de celles-là, moi qui sais ce qu’est une pêche. Moi, aussi bien que les autres paysans, quand nous voyons les paniers de l’épicier pleins de ces fruits-là et les gens de la ville se précipiter sur cette nourriture, nous pensons que ce n’est pas possible d’être affamé à ce point-là ».
Un lien avec le cours de Terminale : Quelle action publique pour l'environnement
I. Encastrer l’économie dans les dynamiques naturelles
Chaque partie du livre commence par un détour historique pour bien montrer qu’il ne s’agit pas de « partir d’une page blanche ». La première partie s’ouvre sur une référence à Carl von Linné (1749) qui étudie l’interaction entre les espèces et les milieux naturels dans lesquels elles vivent. Ses expériences, par exemple pour acclimater des végétaux en dehors de leurs milieux d’origine de manière à éviter de longs et coûteux transports entre lieux de production et de consommation, le conduisent à penser que l’homme devrait avoir une influence limitée sur la nature. Malheureusement, les enjeux environnementaux ont été très rapidement écartés au profit d’enjeux purement économiques avec la Révolution Industrielle.
Plus proche de nous, le courant du land economics a vu le jour aux Etats-Unis au tournant du 20ème siècle et s’est développé au sein de l’école institutionnaliste Américaine. Il s’agit, pour cette école, d’articuler principes théoriques et réalités pratiques pour déboucher sur des recommandations opérationnelles au plan politique. C’est ainsi que des économistes vont s’interroger sur les régimes de propriété les plus favorables à la conservation des ressources naturelles (Ely, 1918). Le dialogue avec les scientifiques spécialistes de la nature est encouragé, une approche systémique de l’écologie se développe (Leopold, années 1930) : les animaux, les végétaux, les humains, le sol constituent « un organisme qui ne peut pas survivre à l’affaiblissement d’un de ses membres ». L’interdisciplinarité, tant encouragée aujourd’hui au sein de nos universités, est alors jugée nécessaire pour que l’économie puisse rendre compte des enjeux environnementaux.
Aujourd’hui, l’économie écologique traite de l’économie circulaire, du développement soutenable, de la gestion des ressources communes et de la prise en compte des limites biophysiques dans les modèles économiques. En référence à René Passet (1979), les auteurs écrivent que l’économique est placé en position instrumentale par rapport au politique, le système écologique contraignant le tout. Les écosystèmes ne peuvent plus, dès lors, être considérés comme étant uniquement au service des usages humains. Daly (1990) énonce les trois conditions pour tendre vers une « durabilité forte » (qui permet le maintien des niveaux de capital naturel) : limiter notre consommation de ressources renouvelables pour permettre leur renouvellement, adapter nos consommations de ces ressources au rythme des innovations qui pourraient les remplacer, ne pas polluer au-delà des capacités d’absorption des écosystèmes.
Voir l'étude de cas : L'économie circulaire. Le cas Altempo
II. Reconnaître la dette écologique des systèmes économiques
L’exploitation des richesses naturelles engendre une dette vis-à-vis de la nature. L’enjeu de la comptabilisation de celle-ci est au cœur de la deuxième partie. C’est un nouveau retour aux économistes institutionnalistes (Veblen) qui permet de lier la consommation « ostentatoire » à ses effets écologiques : gaspillage, surproduction… Polanyi va plus loin, lorsqu’il critique la « marchandisation de la nature ». C’est le célèbre rapport Meadows (1972), sur « Les limites de la croissance », qui modélisait les rétroactions prévisibles entre population, production et pression sur les ressources si le rythme de croissance observée Après-Guerre devait se poursuivre. D’après le rapport, un tel rythme ne serait plus soutenable aux environ de 2030… Nous y sommes et le rapport Meadows, malgré ses multiples rééditions, ne semblent pas avoir plus d’écho aujourd’hui qu’hier ! Des perspectives de prospérité sans croissance sont abordées, reposant principalement sur un renforcement des liens sociaux, la sobriété, l’entraide et le respect des équilibres naturels.
La question de la comptabilité prenant en compte l’érosion de la nature renvoie à la notion d’empreinte, qui mesure le rapport entre les modes de consommation et les surfaces nécessaires pour satisfaire la demande. C’est sur cette base qu’on calcule chaque année le « jour du dépassement », celui où l’exploitation humaine dépasse la capacité naturelle au renouvellement de ce qui est prélevé. De la date du 31/12 en 1970 (pas de dette) nous sommes passés au 1/11 en 1979, puis au 1/10 en 1999, pour atteindre le 1/08 en 2019. Notre rapport à la nature est alors interrogé : les écosystèmes sont-ils une réserve de capital au service des secteurs institutionnels, ou un nouveau secteur institutionnel en interaction avec les autres ? Dans la seconde option, il faut que chaque acteur qui consomme des ressources naturelles paie pour maintenir l’état écologique de celles-ci. C’est tout l’enjeu des travaux de recherche en Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement (CARE).
Lire la note de Lecture : De l’économie d’abondance à l’économie de rareté
III. Nourrir l’être humain sans détruire les écosystèmes
D’emblée, les auteurs affirment que la forme la plus prometteuse de conciliation entre humains et nature repose sur l’agriculture biologique. Le détour historique passe ici par les économistes physiocrates (Quesnay, 1758), qui placent l’agriculture au cœur du cycle dynamique de l’économie. On découvre les travaux de Leroux, au 19ème siècle, qui pose les bases de ce qui est aujourd’hui l’économie circulaire avec l’organisation de la circulation des nutriments naturels des sols. Notons au passage que cet auteur plaide pour que chaque ouvrier dispose d’un lopin de terre pour se nourrir, idée que l’on retrouvera en 1943 sous la plume de Simone Weil dans son célèbre ouvrage « L’enracinement ».
Le chapitre sur « l’ornithologie économique » est l’un des plus surprenants lorsqu’on ne connait pas ce courant d’études qui s’est développé au début du 20ème siècle. Des ornithologues et des économistes collaborent alors pour étudier le rôle des oiseaux pour lutter contre les populations de ravageurs de cultures. Il est remarquable d’observer que l’utilité des oiseaux ne s’arrête pas à leur capacité d’ingestion d’insectes mais est abordée aussi sous l’angle récréatif, en prenant en compte le plaisir de l’observation et de l’écoute du chant des oiseaux.
L’agriculture évolue, au 20ème siècle, vers une agro-industrie produisant des biens alimentaires homogènes. On perd alors des connaissances accumulées depuis des siècles et on consomme énormément d’énergies fossiles dont on devient dépendants. La mal nommée « révolution verte » engendre des coûts sociaux et environnementaux très élevés : désertification des campagnes, maladies liées à l’usage des pesticides. La dette écologique devient très lourde. La conversion d’exploitations agricoles à l’agriculture biologique est coûteuse et le gain final jamais garanti. Il y a une renonciation à la course à la productivité, il s’agit de substituer du capital naturel et humain au capital physique. Le secteur de l’agriculture biologique reste très fragile et on mesure aujourd’hui son extrême sensibilité à l’inflation.
Voir l'Actu-éco : La politique de soutien à l'agriculture biologique
IV. Apprendre à vivre avec la biodiversité sauvage
La cohabitation entre les humains et la nature sauvage doit être réinventée dans la perspective de la coévolution. L’environnementalisme est né aux Etats-Unis au 19ème siècle (Emerson, 1836 ; Thoreau et son expérience de vie solitaire dans la forêt, 1854), caractérisé par deux mouvements différents : la préservation, qui consiste à sanctuariser la nature, et la conservation, qui repose sur une vision utilitaire de la nature. La préservation a débouché, par exemple, sur la création de parcs nationaux ; la conservation a donné lieu à une gouvernance environnementale dans laquelle les pouvoirs publics supervisent de grands aménagements. La question de la valeur de la nature est l’affaire des philosophes, tout au moins jusqu’en 1960 lorsque l’économiste Krutilla suggère de valoriser la biodiversité biologique. On est alors dans une logique de valeur anthropogénique, par opposition à « anthropocentrée » et donc instrumentale. C’est à partir de là que naît l’idée que la nature ne peut pas être considérée, en économie, comme étant simplement au service des intérêts humains.
Les Américains ont poussé assez loin l’idée du « réensauvagement » de la nature, consistant à favoriser la libre évolution écologique des entités non-humaines. On distingue le réensauvagement passif, qui table sur un retour spontané des espèces sauvages disparues sur un territoire du fait de l’arrêt d’activités économiques sur celui-ci (le loup en France), et le résensauvegement trophique, basé sur la réintroduction volontaire d’espèces (l’ours dans les Pyrénées). On sait que le sujet est complexe et peut diviser les opinions et conduire à des actes extrêmes (abattages illégaux de loups par exemple), les auteurs soulignent l’absence de stratégie nationale en France sur ce thème. A partir de l’exemple des lions de mer aux Etats-Unis, ils décrivent des « processus coévolutifs, impliquant des changements organisationnels et institutionnels », et débouchant sur de nouveaux compromis.
Concernant les dimensions économiques du réensauvagement, il est précisé que nous disposons à ce jour de peu de travaux de recherche sur le sujet. On sait cependant que les principaux coûts sont supportés par le secteur agricole, avec des coûts directs sur les cultures et l’élevage en particulier. Des discussions impliquant toutes les parties prenantes devraient accompagner les programmes de réensauvagement, ce qui suppose, selon les auteurs, un préalable : accepter que les humains n’aient plus l’exclusivité de l’usage de leur environnement naturel.
V. Transformer le contrat social en un contrat naturel
Depuis quelques années, les exemples qui attribuent des droits à des espèces ou à des milieux naturels se multiplient (droit des animaux, des fleuves…). Là encore, nous pouvons citer Jean Giono, visionnaire sur le sujet lorsqu’il écrit le « Prélude de Pan » (Solitude de la Pitié, 1932). Un étranger arrive dans un village du Trièves et assiste à une scène dans laquelle un bucheron a martyrisé une colombe et joue avec elle sur la table d’un café. L’étranger attire l’animal sur son épaule et la protège, refusant de la rendre au bucheron menaçant : « Je la garde, disait l’homme. Elle est à moi. De quel droit, toi, tu l’as prise et tu l’as tordue ? De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise ? Dis-moi ! Ça a du sang, ça, comme toi ; ça a du sang de la même couleur et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi. Tu n’as pas plus de droit que la bête. On t’a donné la même chose à elle et à toi ».
Les auteurs décrivent la longue histoire de l’évolution des droits d’accès à la nature, avec le développement de la propriété privée, en particulier à partir de l’assèchement des zones humides en France ou la privatisation des forêts en Angleterre. L’idée du philosophe Locke, selon laquelle le travail légitime l’appropriation privée, s’applique alors pleinement. La notion de biens communs est remarquablement bien décrite dans l’ouvrage, avec une contestation de la théorie de Harding (1968) sur la « tragédie des communs ». Il s’agit de l’idée selon laquelle, en l’absence de droits de propriété privés, les ressources communes seraient appelées à disparaître en raison de leur surexploitation. Le biais de ce raisonnement repose sur l’application systématique de la « loi du plus fort » et du primat des intérêts individuels. On retourne alors, à nouveau, aux institutionnalistes et à Commons, qui invite à penser que des transactions de droits complètent les transactions matérielles. C’est un faisceau de droits qui lie le propriétaire d’un bien à d’autres personnes lorsqu’il s’agit d’en définir l’usage : accès, gestion, exclusion, aliénation… Ostrom est, bien entendu, citée au sujet de la propriété commune de ressources naturelles. Des communautés parviennent à s’entendre sur ce sujet en délibérant, en établissant des règles collectives et en prévoyant des sanctions en cas de manquement. Pour Ostrom, les biens communs sont à la fois des biens rivaux, ce qui signifie que lorsqu’un agent consomme une part d’un bien, un autre ne peut pas consommer la même part, et des biens non-exclusifs, c’est-à-dire libres d’accès (exemple : les réserves de gibier pour la chasse).
Le contrat social peut devenir un contrat naturel si on considère que la nature n’est plus uniquement un instrument au service des êtres humains. La prise en compte des intérêts non-humains progresse lentement dans le monde. Elle dépend, selon les espèces, de deux critères : les risques d’extinction des espèces et la distance phylogénétique avec les êtres humains. Les auteurs affirment cependant que « le droit peut être à la proue de la transformation écologique de l’économie au 21ème siècle », ils se réfèrent à nouveau à Commons, qui écrivait en 1924 que ce sont les décisions de justice qui sélectionnent les comportements émergents désirables pour les sociétés.
Dans le cadre de la théorie des communs, la nature acquiert un statut de partie prenante et n’est plus considérée uniquement comme une ressource. On observe, dans certaines circonstances (exemple sur l’île d’Ouessant), une « déprivatisation » des écosystèmes et des espèces. Aux Etats-Unis, des dispositifs contractuels encadrent ce mouvement (dit des « servitudes ») par lequel on démembre la propriété privée au profit de la nature. Les droits d’usage (chasser, construire, utiliser des pesticides…) sont retirés au propriétaire, qui peut cependant accéder à son bien et dispose de la possibilité de le vendre. Il bénéficie en contrepartie d’incitations fiscales. Le sujet est complexe comme l’illustre l’exemple de l’ouverture des sentiers littoraux en France : on déprivatise partiellement mais cela peut engendrer des nouvelles dégradations de l’espace naturel.
Conclusion
Les auteurs présentent leur travail comme un « vade mecum d’une économie de la coévolution ». L’apprentissage de la vie avec la biodiversité sauvage implique, selon eux, une révolution cognitive et managériale. La reconnaissance des droits de la nature nous conduira à changer nos arbitrages politiques, économiques et sociaux. L’enjeu est de « bâtir les conditions d’une prospérité nouvelle, non plus contre mais par et pour la nature ».
Quatrième de couverture
En s'appuyant sur des travaux de naturalistes et d'économistes des siècles passés tout autant que sur l'observation d'évolutions récentes relatives à la prise en compte de la diversité du vivant, cet essai montre qu'une autre prospérité est possible, dans le respect des limites planétaires.
Un livre en partenariat avec la Fondation Veblen.
À l'aube de la sixième crise d'extinction du vivant, provoquée par un modèle économique insoutenable et encore largement aveugle à ses propres dégâts, il y a urgence à transformer radicalement nos façons de produire et de consommer, nos conceptions du monde, nos institutions, voire notre contrat social. L'exploitation de la biosphère nécessaire au développement des sociétés humaines a été tour à tour fondée sur une économie de la prédation puis de la production, avec des conséquences terribles pour la biodiversité. Un des enjeux du XXIe siècle est de faire émerger une économie de la coévolution permettant de redéfinir notre rapport avec la nature.
Les auteurs
Harold Levrel Économiste de l’environnement, professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et chercheur en économie écologique au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired).
Antoine Missemer est chercheur en économie au CNRS, Cired.





