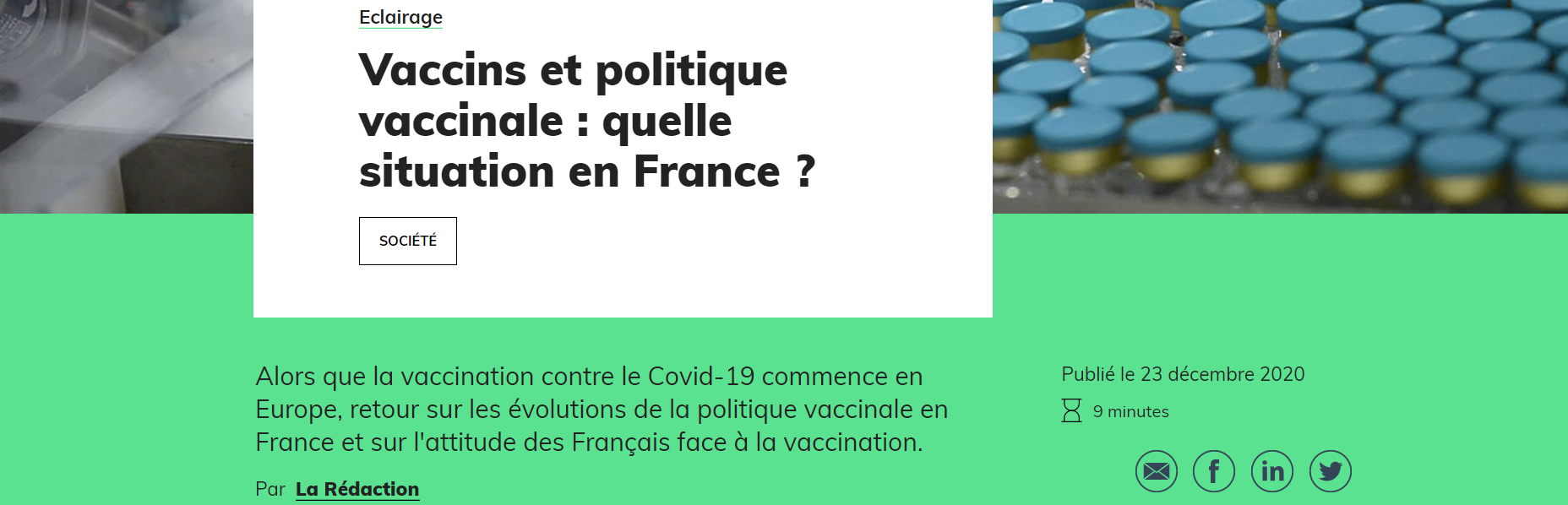Modalité : En présentiel, accès internet nécessaire / Distanciel possible.
Lien vers l’éclairage Vaccins et politique vaccinale : quelle situation en France ? publié par Vie publique le 23 décembre 2020.
Questions :
1. Rechercher et définir – Quel est le principe de la vaccination ?
2. Expliquer - Par la vaccination, se protège-t-on soi-même ou protège-t-on les autres ?
3. Déduire – Si l’on protège les autres en se vaccinant, à quelle notion économique, étudiée dans les questionnements sur le marché, pouvons-nous avoir recours ici ?
4. Expliquer – La vaccination correspond à une gestion collective des risques mais selon quel principe : prévention, mutualisation ou partage des risques ?
5. Expliquer – Décrivez la « balance bénéfices/risques » citée dans le document, du point de vue de l’État.
6. Expliquer – Le principe de prévention implique deux axes d’action : l’information et la réglementation. Retrouvez ces deux axes dans « l’éclairage » de Vie publique.
7. Rechercher et définir - Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la vaccination contre la Covid est un « bien commun mondial » à construire. L’utilisation de la notion de bien commun est-elle pertinente dans ce cas ?
Voir la correction
1. Rechercher et définir – Quel est le principe de la vaccination ?
Les vaccins « visent à protéger les individus contre les maladies contagieuses et transmissibles ». Plus précisément, si l’on s’en tient aux vaccins préventifs 1, vacciner consiste à injecter dans le corps d’un individu en bonne santé un agent infectieux (virus ou bactérie), sous une forme inoffensive mais stimulant la réponse immunitaire de l'organisme. Le système immunitaire disposant d'une forme de mémoire, une exposition ultérieure à l'agent infectieux déclenchera une réponse rapide et donc plus efficace.
Un vaccin peut être utilisé contre des maladies dues à des virus ou des bactéries. Ainsi les vaccins contre la rubéole, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite ou encore la grippe prépare le corps à se défendre contre des virus. Les vaccins qui protègent contre des maladies dues à des bactéries sont ceux contre la coqueluche, la tuberculose, le tétanos, l'hépatite B.
[1] Contrairement aux vaccins thérapeutiques qui aident l’individu à lutter contre sa maladie, comme le cancer ou le virus VIH.
2. Expliquer - Par la vaccination, se protège-t-on soi-même ou protège-t-on les autres ?
Le vaccin a un effet protecteur sur l’individu lui-même mais, en cas de maladie transmissible, il a un impact sur la population en général en réduisant le nombre de personnes susceptibles de contribuer à la dissémination d’une maladie.
Au-delà, Chantal Gueniot, docteur en médecine, précise, dans l’encyclopédie Universalis, que certains vaccins sont essentiellement « altruistes » : ils protègent davantage les autres que soi-même. Ainsi du vaccin contre la rubéole, appliqué aux nourrissons : il ne supprime pas l’épidémie mais prévient le risque de rubéole congénitale. En vaccinant tous les bébés, on prémunit les futures femmes enceintes de contracter cette maladie.
Remarque : selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), les cancers, les maladies respiratoires chroniques (comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou l’asthme) et le diabète.
3. Déduire – Si l’on protège les autres en se vaccinant, à quelle notion économique, étudiée dans les questionnements sur le marché, pouvons-nous avoir recours ici ?
La vaccination génère des externalités positives : tout individu qui se fait vacciner accroît le degré de protection de la population générale contre les maladies transmissibles sans que cela ne génère pour lui une récompense monétaire.
Considérées comme une défaillance de marché, les externalités expliquent que la vaccination soit logiquement du ressort de l’État.
4. Expliquer – La vaccination correspond à une gestion collective des risques mais selon quel principe : prévention, mutualisation ou partage des risques ?
La vaccination entre dans le cadre des politiques de santé publique de prévention. Il s’agit de réduire le risque de transmission de certaines maladies, comme la Covid-19, ou de réduire l’importance des dommages éventuels liés à une maladie : éviter les complications médicales ou les décès.
Ce volet de la politique de santé est considéré comme insuffisant en France, comparé aux politiques curatives, focalisées sur le soin aux malades.
5. Expliquer – Décrivez la « balance bénéfices/risques » citée dans le document, du point de vue de l’État.
Comme pour tout médicament, l’examen de la balance bénéfices/risques permet de décider, ou non, que l’administration de vaccins a des bénéfices individuels et collectifs supérieurs aux coûts de la non-vaccination.
Parmi les bénéfices, interviennent des considérations sanitaires de prévention des maladies ; des aspects économiques en diminuant le recours aux soins, les hospitalisations, les handicaps ou encore les absences de travail, etc. ; des aspects sociaux (éviter l’éviction de l’école et l’interruption de la scolarité par exemple).
Quant aux risques, il s’agit des effets indésirables éventuels, les cas de complication repérés ensuite.
On constate à l’heure actuelle que le risque peut être aussi pensé au sens large : sur le plan politique, la politique de vaccination dans les situations de pandémie peut être de nature à cristalliser les mécontentements de la population contre le pouvoir en place.
Enfin, l’on peut souligner que la vaccination a un coût économique (achat des doses, administration des vaccins, campagnes de prévention) : selon l’OMS et sur le fondement de diverses études européennes, le coût statistique moyen d’un cas de rougeole en Europe est de l’ordre de 520 euros pour un vaccin qui n’en coûte que 26.
Il est également possible de poser la balance bénéfices/risques de la non-vaccination.
6. Expliquer – Le principe de prévention implique deux axes d’action : l’information et la réglementation. Retrouvez ces deux axes dans « l’éclairage » de Vie publique.
Information :
- publication d’un « Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales » annuel par la Haute Autorité de Santé.
On peut ajouter :
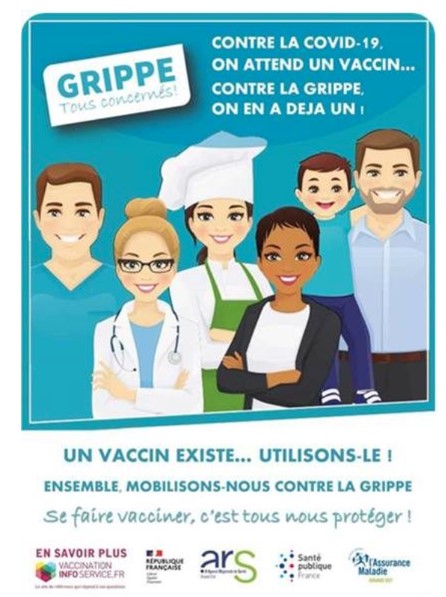
- campagnes de sensibilisation annuelles (agences régionales de santé, ici en 2020).
- communiqués de presse du ministère de la santé et des solidarités sur la vaccination contre la Covid-19
Réglementation :
- élargissement temporaire du caractère obligatoire des vaccins recommandés de l'enfant le 1er janvier 2018 : 11 vaccins sont obligatoires (en comptant ceux contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qui l'étaient déjà) dans les 18 premiers mois du jeune enfant.
- recommandations spécifiques envers certaines populations : personnes souffrant de certaines pathologies ou exposées à des risques particuliers dans le cadre de leur activité professionnelle (le vaccin contre l’hépatite B pour le personnel soignant par exemple).
- des vaccinations sont également obligatoires pour les voyageurs vers certaines destinations.
- stratégie vaccinale contre la Covid-19 en 3 phases, comprenant d’emblée les personnes âgées vivant en Ehpad.
7. Rechercher et définir - Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la vaccination contre la Covid est un « bien commun mondial » à construire. L’utilisation de la notion de bien commun est-elle pertinente dans ce cas ?

En SES, nous avons appris que, comme les biens collectifs, les biens communs sont non excluables (on ne peut empêcher personne de les utiliser, notamment sans payer). En revanche, les biens communs sont rivaux, c'est à dire que les quantités consommées par un agent ne sont plus disponibles pour les autres[2].
Contrairement aux feux d’artifice ou aux ressources halieutiques, les vaccins ne sont pas, pour l’heure, des biens communs : ils sont rivaux, la quantité suffisante doit être fabriquée ; excluables car la puissance publique finance leur achat auprès des laboratoires pharmaceutiques privés qui ont développé la recherche et développement de ce produit. Le faible approvisionnement des pays en développement montre qu’il n’y a pas de répartition commune et équitable. Ainsi, le directeur général de l’OMS a averti les dirigeants contre le « nationalisme vaccinal ». Pour y faire face, le Covax, dispositif onusien piloté par l’OMS, fédère 156 États afin de faciliter l’accès des pays pauvres au vaccin contre la Covid-19 : c’est un mécanisme de financement et de groupement des achats des pays membres qui devrait permettre de disposer de 2 milliards de doses d'ici à la fin 2021 - dont la moitié sera destinée aux pays à faible revenu.
[2] Contrairement aux vaccins thérapeutiques qui aident l’individu à lutter contre sa maladie, comme le cancer ou le virus VIH.