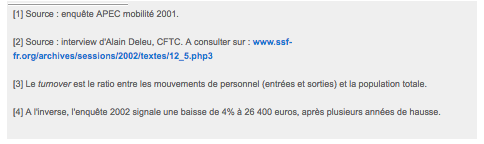Entre 1998 et 2001, la mobilité externe des cadres est passée de 11% à 8% 1 . Ces données soulignent à quel point cette population salariée est sensible aux variations conjoncturelles. De fait, au-delà même de la population des cadres, les évolutions macroéconomiques influencent fortement l'attitude des acteurs du marché du travail. Les variations du niveau de croissance conditionnent les comportements des entreprises en matière d'emploi, mais aussi ceux des salariés et de leurs organisations syndicales.
La croissance du PIB a un effet positif sur les créations d'emploi et sur les rapports de force au sein du marché du travail. Le niveau de création d'emploi est fortement influencé par le niveau de productivité du travail. La relation entre croissance et emploi n'est pas non plus immédiate : l'emploi constitue une variable retard. Les travailleurs, leurs organisations syndicales et les entreprises n'ont donc pas le même horizon temporel, et peuvent rencontrer, en période de retournement de cycle, des difficultés à lier offre et demande.
Crise économique, faible croissance : un marché du travail sous tension
Pour les entreprises, une gestion de l'emploi sans marge de manœuvre
En période de difficultés économiques, les pratiques de recrutement sont très pointues, voire pointilleuses, en termes de sélection des profils. Les créations de poste sont peu nombreuses et les départs volontaires (démissions) tendent à se raréfier. Ceci renforce le phénomène "d'hypersélection". Durant les années les plus difficiles de la décennie 1990, des méthodes de travail s'étaient, en la matière, imposées. Les recruteurs, qui étaient clairement en position de force vis-à-vis des candidats, recherchaient des profils directement opérationnels sur les postes, et parfois surqualifiés.
Cette situation aboutissait concrètement à deux types de pratiques. Premièrement, les méthodes de sélection des candidats devenaient excessives quant aux critères de choix entre les candidatures. Par exemple, le recrutement d'un contrôleur de gestion expérimenté dans l'industrie impliquait de trouver un candidat venant impérativement du même métier industriel. Ainsi, une personne ayant "fait son CV" dans l'industrie électronique ne convenait pas si l'on recrutait dans l'industrie automobile. Les critères d'ancienneté sur le poste, de connaissance des logiciels professionnels, de diplômes étaient tels que les personnes recrutées étaient rapidement à même d'assurer le poste en toute autonomie. Ceci générait néanmoins un effet pervers : le salarié est généralement moins motivé quand il ne dispose d'aucune perspective d'apprentissage.
Par ailleurs, l'hypersélection posait d'autres problèmes plus profonds. Certains secteurs recrutaient des diplômés de BTS et DUT à des postes d'opérateurs dans l'industrie, dont le niveau de qualification ne requérait que des personnes ayant un CAP, BEP ou éventuellement un baccalauréat professionnel. Ceci avait pour double effet de dévaloriser les diplômes et de maintenir un taux de chômage élevé dans les populations peu qualifiées. Les pratiques de gestion de l'emploi étaient elles aussi affectées : les recrutements sous forme de CDD étaient plus nombreux qu'en CDI, et ce davantage pour des raisons d'opportunité que de conformité juridique.
Les licenciements constituent une autre facette de la gestion de la main-d'œuvre dont l'évolution est fortement corrélée au niveau de croissance du PIB. Ceci concerne tant les licenciements pour motif économique que ceux pour motif personnel (liés en général à des fautes professionnelles plus ou moins importantes). Le recours au motif personnel a été détourné par certaines entreprises, afin de contourner la législation sur les plans sociaux. Cependant, on constate une chute tendancielle du nombre de licenciements économiques depuis le début des années 90, à l'exception de la période fin 2001 qui constitue une période d'ajustement forte et exceptionnelle, après d'importantes créations de postes en CDI.
Ce contexte de faibles créations (voire de destructions) d'emploi, impliquant peu de recrutements et, éventuellement, des licenciements, ne peut que laisser de faibles marges de manœuvre aux sociétés en matière de gestion des carrières. Les cycles économiques peuvent donc générer des phénomènes de démotivation en période de récession ou de stagnation. Les opportunités de carrière sont plus rares et les carrières plus longues pour obtenir des responsabilités. Sur le plan des perspectives salariales, un travailleur dont les performances sont bonnes peut ne pas recevoir d'augmentation du fait des restrictions budgétaires. En période de compression de la masse salariale, il subit ces situations et sa productivité peut diminuer par manque d'incitation et de reconnaissance.
Les travailleurs et leurs organisations syndicales
La mobilité externe d'emploi à emploi des salariés a tendance à fléchir en période de crise. Tout d'abord, les chances de trouver un autre emploi sont plus faibles. En outre, le risque d'échec durant la période d'essai du futur emploi est ressenti de manière plus aiguë. Ceci constituerait un "trou" (moment de chômage) dans le CV et créerait des difficultés en termes de repositionnement sur le marché du travail. Ceci tend à diminuer le taux de démission. Ainsi, fin 2002, le pourcentage de démissions dans les sorties de personnel du secteur salarié est passé de 22% au troisième trimestre à 20,5% au quatrième trimestre car les effets sur l'emploi commençaient à être anticipés.
Le risque de démotivation et de chute de la productivité est réel : les carrières sont plus longues, plus exigeantes et les perspectives salariales moins stimulantes. Cependant, le risque de chômage est accru, ce qui limite la portée de ce phénomène. Les fondements de la productivité demeurent néanmoins fragiles dans ce type de situations.
La flexibilisation des politiques de l'emploi en période de crise pose de sérieux problèmes de sécurité financière et professionnelle à certaines catégories de la population active. La précarité et le risque de paupérisation d'une frange des travailleurs sont des problèmes qui ont des conséquences économiques (une partie de la population est de moins en moins solvable) et sociales (une partie du salariat a un accès plus difficile à certains dispositifs comme le crédit ou le logement).
Le rôle des organisations syndicales est de porter ces thèmes au niveau des entreprises et des négociations nationales. La force de frappe des syndicats est cependant relativement faible. Sans préjuger d'autres formes d'action, il est nécessaire de rappeler que quantitativement, les conflits sociaux (évalués en l'occurrence par le nombre de jours de grève) évoluent inversement à la courbe du chômage. La création d'emploi a donc une influence sur la quantité de jours de débrayage. En 1988, 1 095 000 journées de grève étaient comptabilisées. En 2001, on n'en compte plus que 700 000 journées2 . La chute est quasi continue depuis les années 1970.
En période de crise, a fortiori, les relations sociales sont plus tendues. Le rapport de force est favorable aux entreprises, mais, parallèlement, les opportunités de conflits sociaux se multiplient : plans sociaux, insatisfaction quant aux conditions de travail et au niveau des rémunérations, etc. Des conditions économiques défavorables augmentent les chances de radicalisation des conflits.
Toutes ces considérations pourraient amener à penser que le marché du travail est uniforme et que la crise généralise ces comportements. Cette vision serait pourtant partielle. En effet, même durant les périodes les plus difficiles, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre peuvent perdurer. Le secteur du BTP en est une exemple : bien que la demande de compétences soit importante, on constate des difficultés de recrutement. Celles-ci ne sont pas compensées par des entrées importantes dans le secteur d'activité : la baisse du nombre de jeunes inscrits dans des formations (lycée professionnel ou alternance) est de 3,28% entre 2000 et 2001.
L'offre de travail peut s'avérer faible car des emplois sont peu attractifs : la pénibilité importante des tâches, l'image dégradée du métier, les problèmes de mobilité, de qualité du management ou de niveau de rémunération, etc. peuvent fortement diminuer le nombre de candidats, ainsi que leur niveau d'adaptation. Ceci peut expliquer pourquoi, même en période de crise, certains employeurs éprouvent de réelles difficultés à pourvoir des emplois.
En période de croissance : l'émergence de comportements opportunistes
De la gestion du turnover aux politiques d'attractivité
Le turn-over3 est en phase avec l'activité économique : plus la croissance est forte, plus les mouvements de personnel sont importants. Les comportements "d'abeilles butineuses" se multiplient chez les salariés quand les opportunités professionnelles sont plus nombreuses. La concurrence peut même, sur certains profils, changer de domaine : c'est alors aux entreprises d'être (ou de paraître) les meilleures pour recruter.
La mise en place de politiques d'attractivité est alors indispensable à la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Celles-ci passent par l'augmentation des rémunérations (hausse des salaires de base et des attributions de primes), mais aussi par l'apparition ou le développement des rémunérations périphériques. Celles-ci prennent la forme d'accords d'intéressement, de plans d'épargne entreprise, de stock-options, etc. Ces outils sont rarement utilisés en période de crise mais se développent quand les perspectives de profit s'améliorent.
L'attractivité ne peut être conçue sous le seul angle financier. L'amélioration des conditions de travail est un levier étrangement sous-estimé, qui diminue le coût lié au turn-over (temps de formation sur le poste, enjeu temporel et financier d'un recrutement, perte de mémoire de l'entreprise, etc.). Les politiques de communication en matière sociale peuvent obtenir des effets, surtout quand une entreprise a pris conscience des limites de certains aspects de sa politique. Elle peut diffuser une image plus positive de sa politique de gestion des ressources humaines, à condition que ne s'installe pas un décalage permanent entre les pratiques et la communication. Les modes de management peuvent eux aussi changer du fait de l'évolution des rapports de force sur le marché du travail, et mieux prendre en compte certaines attentes des salariés, surtout en matière de reconnaissance.
Les entreprises peuvent connaître des difficultés à rentrer dans cette logique d'attractivité (c'était le cas à la fin des années 90) car elles se sont installées dans des modes de gestion qui doivent alors être remis en cause profondément. Ceci demande du temps et ce sont parfois des crises profondes qui provoquent ce phénomène. De plus, les politiques d'attractivité et de fidélisation connaissent d'importantes limites. En matière financière, les règles de gestion de la masse salariale sont en effet souvent trop contraignantes au sein des entreprises pour pouvoir attribuer d'importantes augmentations de salaire, à même d'assurer aux salariés des rémunérations fortement attractives (les augmentations de salaire à deux chiffres sont rares dans la plupart des entreprises). Ces politiques peuvent même contribuer à maintenir le niveau de turn-over (car les nouveaux arrivés, mieux payés, irritent…et les salariés déjà en place souhaitent eux aussi profiter des ajustements du marché).
Des travailleurs plus exigeants et plus opportunistes
Les démissions ont tendance à augmenter en période de croissance : non seulement les chances de trouver un autre emploi sont plus élevées, mais en plus les travailleurs en recherche d'une importante augmentation de salaire sont souvent dans l'obligation de changer d'entreprise. Le turn-over est alors en hausse, ce qui complexifie la gestion du personnel.
Afin de fidéliser les salariés et de proposer des perspectives intéressantes aux candidats, les carrières deviennent plus rapides. Les plus importants cabinets de conseil comme Accenture ou Price Waterhouse Coopers nommaient des managers plus jeunes afin de répondre à la croissance de leur structure et aux aspirations des membres de leur personnel. De même, le salaire moyen d'embauche des jeunes diplômés constitue en général un bon indicateur de tension sur le marché des jeunes cadres. Ce dernier est passé de 24 700 euros en 1998 à 27 600 euros en 20014 .
Le discours syndical et les revendications peuvent alors se réorienter non seulement vers les rémunérations, mais aussi en direction des conditions de travail et des questions d'organisation. Ceci n'était pas anodin durant la période 1998-2000, car les principales organisations s'étaient progressivement repositionnées sur les questions de création d'emploi durant la période de fort chômage de la décennie 1990.
Des blocages structurels peuvent cependant freiner la création d'emploi en période de croissance. Ainsi, la rencontre entre offre et demande peut ne pas être assurée pour de simples raisons d'inadéquation. Des SSII (Sociétés de Services en Ingénierie Informatique) comme STERIA ou UNILOG voyaient leur croissance entravée en 1999-2000 car les postes d'ingénieurs informaticiens ouverts ne trouvaient pas tous un candidat adapté. Les problèmes de formation sont souvent à l'origine de ces dysfonctionnements du marché du travail : le système éducatif, mais aussi la formation continue n'assurent pas un rôle continu d'adaptation de la main-d'œuvre au contexte économique pour tous les secteurs d'activité.
Les retournements conjoncturels : des comportements et attentes déphasés
De la croissance à la crise
Les salariés acceptent difficilement de rentrer dans de nouveaux modes de gestion des ressources humaines en cas de ralentissement accéléré de la conjoncture. Ce comportement est humainement compréhensible : les salariés sont réticents à travailler autant, voire plus, pour des perspectives financières et professionnelles moins attrayantes. Les jeunes diplômés, pour leur part, font partie des principales "victimes" des ralentissements.
Les politiques de ressources humaines des entreprises, quant à elles, s'adaptent très rapidement à la conjoncture. Sous la pression des actionnaires ou des finances de la société, les dispositifs auparavant engagés sont rapidement gelés. Ces adaptations entretiennent parfois une suspicion par rapport aux politiques sociales des entreprises, de plus en plus "court-termistes". C'est parfois la crédibilité même de la fonction qui en est altérée : les salariés réalisent rapidement que les discours tenus sur leurs politiques par les directeurs des ressources humaines ne résistent que rarement aux revirements de décision quand la conjoncture est moins bonne.
Les décélérations économiques génèrent d'autres effets pervers. Le fonctionnement même du système d'assurance chômage peut désinciter certaines personnes à travailler car les salaires proposés lors de leur recherche d'emploi (en période de crise) ne sont parfois que très légèrement supérieurs à leurs indemnités ASSEDIC. L'incitation financière au travail ne porte que sur de faibles sommes. Le système d'indemnisation des chômeurs devrait mieux prendre en compte ces configurations qui nuisent à l'employabilité de la population active.
La période récente, accentuée par les événements du 11 septembre 2001, a fortement touché des acteurs incontournables du marché du travail : les entreprises de travail temporaire et les cabinets de recrutement. Ceux-ci ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler fin 2001, après une période euphorique. Ce contexte de forte croissance s'était cependant avéré largement exceptionnel. Des sociétés comme Robert Half ou Michael Page avaient alors connu une expansion surprenante en accompagnant des clients qui utilisaient des intermédiaires afin de satisfaire leurs besoins de recrutement.
Les pratiques d'externalisation ont aussi eu pour conséquence de déplacer l'ajustement du niveau de main-d'œuvre dans l'économie sur les sociétés de services (de certains secteurs comme l'ingénierie). Ces entreprises sont alors tentées, voire forcées, de pratiquer des politiques sociales plus dures, et ce sans concertation avec le personnel et leurs représentants.
Le redémarrage de l'économie et le retour à la croissance
Dans ce cas de figure, les entreprises modifient difficilement leurs pratiques de gestion, qu'elles ont parfois mis des années à stabiliser. En 1998-2000, les tensions sur le marché du travail ont balayé certaines méthodes anciennes, et les recruteurs ont dû apprendre à sélectionner des candidats tout en les "séduisant" pour les attirer dans leurs entreprises. Ceci a eu pour avantage de faire disparaître les phénomènes de sur-sélection auparavant constatés, mais aussi le recours trop systématique aux contrats temporaires (CDD et intérim) dans des situations qui ne l'exigeaient pas. Ces contrats ont tout de même la particularité d'être les premiers modes de recrutement, en attendant que les employeurs prennent conscience que la croissance s'installe dans la durée.
Le phénomène start-up peut être analysé, au-delà du très puissant effet de mode à l'époque, comme une réaction de nombreux cadres aux pratiques de gestion du personnel et d'organisation du travail de grandes entreprises. Des sociétés prestigieuses comme Schneider Electric, BNP Paribas, etc. ont connu de nombreux départs de travailleurs durant cette période de forte croissance.
Les salariés, après des périodes de difficultés sur le marché de l'emploi, peuvent devenir exubérants dans leurs demandes. Après avoir connu une gestion des carrières et des perspectives d'augmentation limitées, ils peuvent afficher une hyper exigence qui devient impossible à satisfaire. Ces comportements sont susceptibles d'altérer les relations de travail au sein des équipes car le principe d'équité, indispensable à un sain fonctionnement, est "oublié" au profit de considérations court-termistes liées au souhait de recruter rapidement ou de faire une concession à quelqu'un qui annonce son intention de démissionner. Dans ce type de configuration, les professionnels des ressources humaines touchent les limites de leurs politiques.
Conclusion
Les employeurs et leurs responsables du recrutement sont de plus en plus attentifs aux cycles économiques. Ils sont soumis à des pressions quantitatives (recruter moins, plus mais plus rapidement, etc.) et qualitatives (on recrute plus de CDD que de CDI en période de crise, et vice-versa). La flexibilisation de la gestion de l'emploi a donc eu pour conséquence de rendre le marché du travail plus cyclique.
Les travailleurs et les entreprises semblent s'adapter de plus en plus rapidement à la conjoncture. Cette approche est cependant conditionnée par une logique d'ensemble qui repose sur des intérêts de court terme : gagner plus pour les salariés et maximiser le profit (ou limiter le risque) pour les entreprises. Ceci constitue tout de même un problème de fond car les individus ont culturellement du mal à admettre que la valeur du travail effectué puisse varier d'une période à l'autre. Les entreprises connaissent de plus en plus de difficultés à mettre en place des systèmes qui protègent le salarié des cycles économiques.