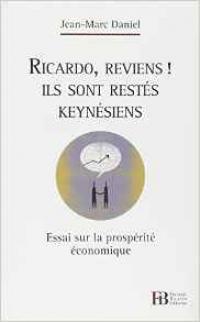L'ouvrage
Depuis l’éclatement de la crise en 2007, il est de bon ton de brocarder les économistes et leur incapacité à avoir prévu les difficultés, ce qui laisse parfois le champ libre aux commentateurs pressés ou aux prophètes pessimistes. Dans son ouvrage, Jean-Marc Daniel affirme que la prospérité économique est possible dans les années à venir, à condition de mettre en œuvre « une politique économique qui réponde, non aux problèmes d’hier, mais à ceux d’aujourd’hui (…) Et le résultat le plus utile de la science économique est que la voie du progrès, de l’innovation, de l’esprit d’entreprise suscité par la concurrence est toujours meilleure que celle du retour en arrière, du déclin et de la routine. C’est en faisant partager ce résultat que les économistes retrouveront leur crédit auprès de la population. Sans a priori dépassés et sans tentation démagogique. La crise a fait la part belle aux Cassandres. Il faut maintenant passer à l’action positive ». Les périodes de crise remettent toujours en cause les analyses sur lesquelles étaient fondées les pratiques économiques qui ont précédé : la crise des années 1970 a vu s’abîmer le consensus keynésien sur l’écueil de l’inflation, avant que le monétarisme et la nouvelle école classique ne prennent le relais comme doctrines dominantes dans le champ académique. La crise en 2007 a donné une nouvelle légitimité au modèle keynésien de politique économique, même s’il est aujourd’hui confronté à l’aggravation de l’endettement public. De la même manière que les années 1960 avaient permis de dépasser les oppositions théoriques entre l’analyse néoclassique et la théorie keynésienne dans le cadre de la « synthèse néoclassique » portée notamment par les travaux de l’américain Paul Samuelson, la période actuelle pourrait être propice à l’émergence d’une nouvelle synthèse. Selon Jean-Marc Daniel, le bon compromis aujourd’hui pourrait consister à conserver de Keynes le rôle déterminant de l’investissement et du cycle économique qu’il nourrit, et défendre à la manière d’un David Ricardo le rôle crucial de la liberté économique et de la concurrence pour combattre les rentes.
Energie, progrès technique et concurrence
La croissance future sera fondée sur trois piliers : l’énergie, le progrès technique et la concurrence. Comme l’estimait déjà les Physiocrates et Adam Smith en leur temps, la croissance économique naît d’une combinaison entre l’énergie et l’intelligence humaine qui permet la baisse des coûts, la hausse de la quantité d’objets créés dans un temps donné, et l’amélioration du pouvoir d’achat puisque le troisième facteur, la concurrence, incite fortement les entreprises à baisser leurs prix sur le marché. La responsabilité de l’Etat est alors de créer un environnement propice à enclencher une boucle vertueuse où l’innovation et la concurrence stimulent les gains de productivité et favorisent l’élévation des niveaux de vie : à l’origine de la révolution industrielle en Europe, de tels mécanismes sont désormais à l’œuvre en Inde et en Chine. La mondialisation de l’économie a en effet profondément réorganisé la géographie économique. Historiquement, le modèle « ricardien » dominé par l’Angleterre et la livre sterling comme monnaie de référence au XIXème siècle dans le cadre de l’étalon or a cédé la place au modèle « keynésien », dominé par les Etats-Unis, leurs déficits « jumeaux » (celui du budget fédéral et de la balance commerciale), et la capacité de la banque centrale américaine à inonder le monde de dollars par une forte création monétaire afin de soutenir la demande intérieure, mais dont les effets externes négatifs se transmettent au reste du monde sous la forme de tensions inflationnistes (hausse du prix des matières premières et des prix agricoles notamment). A un pays dominant épargnant (l’Angleterre) a succédé un pays dominant dépensier (les Etats-Unis) : l’Amérique représente 30% de la demande mondiale et consomme davantage qu’elle ne produit, ce qui se traduit par un déficit commercial qui représente environ 7% de son PIB. En parallèle, la Chine a centré sa stratégie de croissance vers des débouchés pour ses exportations situés dans les pays développés, ce qui lui permet d’enregistrer des excédents des paiements courants très importants qui déstructurent aujourd’hui l’économie mondiale : « les Etats-Unis consomment ; les Chinois travaillent et épargnent, les Indiens développent des programmes informatiques (…) L’inde se définit plutôt comme un partenaire ; la Chine, qui se considère comme une victime du XIXème siècle, croit en son étoile et se vit en puissance dominante du XXIème siècle ». Les mutations de l’économie mondiale et l’entrée de masses nouvelles de salariés sur le marché du travail des pays émergents créent de nouvelles inégalités et de nouveaux équilibres, pourtant différents de ceux du XIXème siècle : « l’ouvrier de Manchester fabriquait des cotonnades vendues à Oxford Street (…) Aujourd’hui l’ouvrier de Shanghai ne travaille pas pour lui ni même pour un de ses compatriotes. Il fournit Wal-Mart en tee-shirts achetés par la population américaine ».
L’essoufflement du modèle keynésien
Néanmoins, malgré un discours traditionnellement empreint de libéralisme et des gouvernements néoconservateurs durant les années 2000, les Etats-Unis sont aujourd’hui confrontés dans la pratique de la politique économique à l’essoufflement du modèle keynésien (« le pouvoir réel est resté aux Etats-Unis entre les mains des keynésiens ») : la politique monétaire américaine a amplifié les évolutions cycliques et fortement perturbé le système économique en maintenant durablement le taux d’intérêt à un niveau inférieur au taux d’intérêt de long terme compatible avec la croissance potentielle de l’économie (déterminé par l’évolution de la productivité et de la quantité de travail mobilisable). La politique monétaire américaine a ainsi, dans la pure tradition héritée de Keynes, sacrifié les équilibres de long terme au court terme, à l’immédiateté, et provoqué un emballement du crédit, une disparition de l’épargne (insuffisamment rémunérée) et un endettement privé excessif. La crise actuelle serait donc, sur le fond, une crise de l’efficacité des politiques keynésiennes qui ont déstabilisé le système financier. Plus que le taux de change sous-évalué de la monnaie chinoise (le yuan), ou les excédents allemands, les responsables de ces déséquilibres ayant débouché sur la crise financière de 2007 sont avant tout les concepteurs de la politique budgétaire laxiste aux Etats-Unis qui a impliqué des taux d’intérêt durablement faibles pour financer plus aisément la dette, à savoir Alan Greenspan, banquier central qui n’a pas durci la politique monétaire de la FED suffisamment tôt, mais aussi les concepteurs des règles comptables et administratives aux Etats-Unis, qui ont favorisé le développement de produits financiers « toxiques » disséminés ensuite dans le bilan des banques. Aujourd’hui, la politique économique keynésienne de l’administration Obama se heurte à trois écueils : une efficacité décevante en matière de croissance, un retour de l’inflation, et surtout un endettement public qui prend aux Etats-Unis un tour très préoccupant (en 2011, la dette publique a atteint les 100% du PIB). En matière de politique économique, les économistes ont parfois négligé la question du temps, or cette question est centrale dans une perspective d’analyse de l’économie dans un cadre dynamique et non statistique : la politique budgétaire a en quelque sorte une mémoire car elle conserve dans le temps les traces des décisions passées avec l’accumulation de la dette publique, mais la politique monétaire a un effet instantané et n’a pas de conséquences aussi durables, même si elle influence les conditions de fonctionnement de l’action budgétaire (en période de taux d’intérêt élevés, la charge de la dette augmente et limite les marges de manœuvre de la relance budgétaire). La banque centrale a ainsi une double mission : assurer le refinancement de l’économie et jouer un rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise. Son objectif prioritaire doit être de prévenir les conséquences délétères de l’inflation sur l’économie (érosion du pouvoir d’achat, perturbation des signaux envoyés par les prix sur les marchés). La banque centrale doit s’intéresser autant à la qualité qu’à la quantité de la monnaie que les banques commerciales mettent en circulation. Elle doit permettre de financer les projets industriels créateurs de richesse et ne pas favoriser la formation d’une bulle de crédit. Dès lors, « une politique monétaire efficace ne lutte pas contre l’inflation mais suscite des anticipations telles que l’inflation n’apparaît pas ».
La politique économique d’après crise
Selon Jean-Marc Daniel, la politique économique d’après-crise doit être basée sur six piliers : une fiscalité des entreprises incitative pour l’investissement, une fiscalité des ménages qui prenne en compte les externalités négatives sur l’environnement (pollution), une dépense publique conciliant l’efficacité économique et la répartition des richesses, une politique active de la concurrence, une politique monétaire de dissuasion de l’inflation et tournée vers la qualité de la création de monnaie. Parallèlement, les Etats doivent se défier de l’illusion protectionniste qui conduirait à une baisse de pouvoir d’achat de la population par une augmentation du prix des importations. De plus, le refus de la concurrence internationale et du libre-échange plongerait les entreprises dans la routine et ne les inciterait guère à faire des efforts de productivité. Selon Jean-Marc Daniel, il vaut mieux suivre la voie résolue de l’insertion permanente dans la mondialisation de façon à ce que le renouvellement « schumpétérien » du tissu économique bénéficie de la « destruction créatrice » décrite par l’économiste autrichien. De plus, comme l’a souvent rappelé le prix Nobel d’économie Paul Krugman, la notion de compétitivité, héritée de la vieille vision mercantiliste (ce que les uns gagnent les autres le perdent) n’a guère de sens dans le cadre d’une économie mondiale où c’est avant tout la politique de productivité qui s’avère payante. Il faut donc se garder de s’engager dans les impasses que constituent les stratégies de déflation salariale ou de dévaluation compétitive, ou autres TVA sociale (un « gadget économique »). La France devrait suivre dans le futur une politique de productivité, mais surtout conduire une stratégie d’assainissement des finances publiques, qui sont dans un état de délabrement avancé : l’accumulation de l’endettement provient de l’accumulation des déficits structurels dus à l’augmentation non maîtrisée des dépenses publiques tolérée par les différents gouvernements depuis les années 1970. Si l’augmentation des prélèvements obligatoires ne parait guère concevable vu le niveau qu’ils ont atteint aujourd’hui, la solution raisonnable consiste à réduire rapidement les dépenses publiques : « dans un pays où les dépenses publiques représentent 56% du PIB, des économies sont possibles ». Au-delà du choix de l’Europe, indispensable à la France, Jean-Marc Daniel évoque quatre pistes prioritaires pour réduire le poids des dépenses publiques dans l’hexagone : une rénovation de l’Etat providence et un arrêt des exonérations de charges sociales liées aux 35h et des dispositifs de défiscalisation des heures supplémentaires mis en œuvre en 2007 (loi TEPA) ; une réduction de la masse salariale dans la fonction publique et l’éducation (il n’est pas avéré que la croissance des dépenses d’éducation entraîne une élévation du niveau de formation) ; une action sur les recettes de l’Etat en développant la fiscalité écologique ; la poursuite du désengagement de l’Etat de l’économie. La stratégie de croissance de la France devrait reposer en priorité sur les mécanismes de la concurrence, de l’innovation : le rôle de l’Etat demeure important pour créer un environnement qui incite les entreprises à l’investissement (refonte du droit du travail pour davantage de flexibilité du travail, politique de réduction de coût du travail, formation des travailleurs, politique de concurrence contre les rentes de l’économie française).
L'auteur
Diplômé de l’Ecole polytechnique, universitaire et économiste, Jean-Marc Daniel est chroniqueur au Monde et sur la radio BFM-Business. Il est l’auteur de La Politique économique (« Que sais-je ? »), 2008), Histoire vivante de la pensée économique (Pearson éducation, 2010) et Le Socialisme de l’excellence (François Bourrin Editeur, 2011).
Table des matières
Introduction
Chapitre 1. Le monde et sa croissance.
Chapitre 2. Crise et essoufflement du modèle keynésien.
Chapitre 3. Le cycle et la relecture de la politique économique.
Chapitre 4. Ne pas se tromper : choisir la mondialisation et éviter le protectionnisme.
Chapitre 5. La France et la politique de productivité.
Conclusion.
Quatrième de couverture
La crise ébranle le monde. Une situation inespérée pour les adorateurs de l’apocalypse qui annoncent la déroute économique, quand ce n’est pas la mort du capitalisme. Selon Jean-Marc Daniel, nous devons cesser d’être systématiquement pessimistes et revenir aux fondamentaux de la science économique. D’après lui, la croissance est possible à condition d’adopter une politique de l’offre inspirée de Ricardo plutôt qu’une politique keynésienne de la demande. La croissance par la concurrence et l’investissement ou le déclin par le déficit public : il faut aujourd’hui choisir.