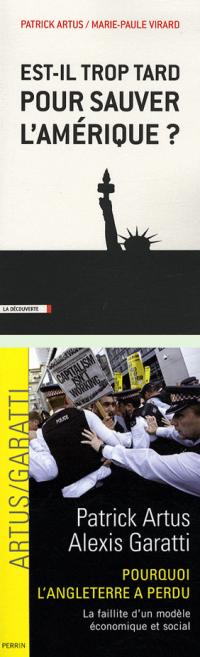L'ouvrage
Le nouveau défi américain
Les espoirs immenses suscités outre-Atlantique par l'élection de Barack Obama, quarante-quatrième président des Etats-Unis, sont à la hauteur des défis économiques et sociaux à relever : la relance d'une économie minée par l'ampleur des dettes et des déficits « jumeaux » (déficit budgétaire et déficit du commerce extérieur), la réduction du chômage sur un marché du travail déprimé par le freinage de la consommation et la remontée de l'épargne, la réforme du système d'assurance maladie dans un pays où 47 millions de citoyens sont privés de couverture sociale, et la lutte contre les inégalités économiques, revenues à leur niveau du premier quart du XXe siècle, constituent autant de chantiers titanesques. Faut-il pour autant parler de déclin irréversible de la suprématie américaine, souvent annoncée mais régulièrement démentie par les faits ?
Le déclin de la puissance industrielle et financière, et même technologique, des Etats-Unis s'inscrit dans un contexte de montée en puissance des ambitions de la Chine, appelée à ravir au cours du XXIe siècle la place de première puissance économique mondiale. Longtemps présentée comme le pays « consommateur en dernier ressort », l'Amérique est confrontée au piège de l'endettement excessif accumulé durant les périodes de bulles financières et au nécessaire soutien massif de la politique monétaire et budgétaire pour compenser le ralentissement de la demande du secteur privé. La crise est bien de nature structurelle puisqu'il s'agit d'une rupture profonde avec le « modèle » édifié à partir des années 1980, en vertu duquel l'addiction des ménages à la dette valide les décisions de production des entreprises, mais nourrit aussi les bulles de crédit : l'accès à la propriété de nombreux ménages américains de la classe moyenne (le taux de propriété a pu atteindre 69 %) a été permis par le développement de produits financiers complexes diffusés ensuite dans le système bancaire et financier, et dont la crise des subprimes a démontré toute la dangerosité.
La mondialisation de l'économie a par ailleurs conduit à une évolution des structures du capitalisme américain : la vigueur des industries tournées vers le high tech s'est conjuguée à l'érosion des industries traditionnelles (comme l'automobile) confrontées aux vagues de délocalisations, et à l'essor de services domestiques à faible valeur ajoutée (dans la grande distribution notamment). Mais ce « modèle bipolaire », articulé autour d'une industrie et des services à haute valeur ajoutée (nouvelles technologies, services financiers), et des services domestiques au sens large (services à la personne, BTP, distribution, loisirs et transports), comporte des risques : les délocalisations, et leur cortège de destructions d'emplois sur le territoire américain, s'étendent désormais à tous les emplois, tandis que l'écart de rémunération se creuse avec les services à faible valeur ajoutée, ce qui nourrit l'aggravation des inégalités et le déficit extérieur dans la mesure où les Etats-Unis sont contraints d'importer de nombreux biens et services en provenance de Chine. Cette dernière accumule alors de gigantesques réserves de change qu'elle place sous forme de titres de la dette publique américaine et soutient de cette manière le dollar... mais jusqu'à quand ? Une diversification des placements chinois pourrait conduite à un effondrement du billet vert sur le marché des changes et à une grave crise monétaire mondiale.
Le président Obama doit donc proposer un substitut au modèle de l'économie d'endettement et restaurer aux Etats-Unis les conditions d'une croissance forte, saine et durable. L'administration américaine doit par ailleurs se saisir de l'urgente question de la rénovation des infrastructures publiques (routes, ponts, réseaux ferrés), souvent dans un état de délabrement avancé. Face à l'ampleur de la dette publique et des déficits des administrations, la politique économique américaine a sans doute utilisé une part importante de ses marges de manœuvre : sa mobilisation sera pourtant durablement indispensable pour soutenir la consommation des ménages amenés à poursuivre leur désendettement (dans cet équilibre, la désépargne publique remplace la désépargne privée). Mais la politique monétaire peut-elle soutenir durablement des taux d'intérêt directeurs faibles sans nourrir de nouvelles bulles financières et fragiliser un peu plus le dollar, déjà affaibli par le déficit de la balance des paiements ? D'autant que les détenteurs des treasury bounds (les titres de la dette américaine) pourraient exiger dans le futur une meilleure rémunération, accroissant d'autant les charges d'intérêt à rembourser pour le Trésor américain.
Mais soumises également au ralentissement de l'économie mondiale et à leurs propres déséquilibres (comme le ralentissement de la croissance et la montée du chômage urbain), les autorités chinoises sont pour l'heure « condamnées » à financer le déficit extérieur américain pour éviter une trop forte appréciation de leur monnaie (le renminbi). Si les Etats-Unis rétorquent souvent, notamment par la voie du président de la Réserve fédérale Ben Bernanke, que la faute incombe à la Chine dont la monnaie nationale est notoirement et artificiellement sous-évaluée, l'émission excessive de bons du trésor américain pourrait alimenter un excès de liquidités dans le monde et préparer de nouveaux déséquilibres financiers.
La fin d'un rêve
La crise a surtout révélé au grand jour les fractures de la société américaine en période de forte poussée du chômage (puisque la faiblesse des mécanismes de protection sociale le rend difficilement tolérable). Depuis de nombreuses années, la montée de la pauvreté est incontestable (37,3 millions d'Américains vivaient sous le seuil de pauvreté en 2007) tandis que le marché du travail se révèle de plus en plus « dualiste », avec un écart grandissant entre les bons emplois (un salaire supérieur à 17 dollars par jour, une assurance santé et un plan retraite) dans les services à haute valeur ajoutée et les emplois occupés par les « working poors » (un travailleur sur quatre environ), et dont la proportion a fortement augmenté dans l'emploi total : confrontés à la paupérisation et à la stagnation des revenus salariaux, ils sont souvent frappés par la précarité et à l'absence de couverture sociale. Les classes moyennes sont également fragilisées par la montée des coûts comme ceux liés aux études des enfants, au logement, et aux achats des biens de la vie courante.
Face à l'accumulation des difficultés, le président Obama peut miser sur les inépuisables capacités de rebond du pays, l'optimisme ancré dans les mentalités, mais aussi sur les points forts de l'économie américaine encore dominante dans de nombreux secteurs productifs (en particulier dans le high tech) et disposant du marché financier le plus attractif du monde. Les Etats-Unis auront toutefois besoin de l'épargne du monde entier (la Chine jouant pour eux le rôle de « banquier ») et de la coopération internationale pour financer leur reprise et retrouver leur rôle de locomotive de l'économie mondiale.
Après la finance
Le modèle économique et social britannique est depuis les années 1970 centré sur l'impératif de flexibilité et la capacité de l'économie à s'adapter aux mutations de l'économie mondiale (à la manière d'un fonds spéculatif ou hedge fund, suffisamment réactif pour profiter de toutes les occasions d'investissement profitables) : les institutions du marché du travail et les choix stratégiques de production sont ainsi fondés sur la recherche de l'efficacité maximale, pour éviter les spécialisations irréversibles. L'activité centrale du Royaume-Uni consiste donc en une activité d'intermédiation de l'épargne mondiale par le biais de la place financière de la City, l'une des plus dynamiques du monde. En contrepartie, le poids de l'industrie manufacturière dans l'économie a fortement baissé (l'emploi manufacturier a diminué de 30 % de 1998 à 2007) tandis que se sont développées les activités de l'industrie high tech (notamment dans les biotechnologies) et des services bancaires et financiers.
Le Royaume-Uni demeure l'une des nations les plus attractives pour les investissements directs étrangers (IDE) et une part très élevée du capital de ses entreprises est détenue par des investisseurs étrangers, signe d'un refus de tout « nationalisme financier ».
A la suite de l'échec des politiques de « stop and go » de régulation de la demande des années 1970 pour cause d'accélération de l'inflation, le gouvernement Thatcher a favorisé une déréglementation très forte de l'économie britannique : libéralisation du marché du travail, ouverture à la concurrence de nombreux secteurs et privatisations ont marqué cette période, avec le maintien d'une politique monétaire d'inspiration monétariste afin de briser l'inflation associée à un excès de création monétaire. Les gouvernements travaillistes ont poursuivi l'ancrage de l'économie sur les activités financières et accentué son insertion dans l'économie mondiale. Par ailleurs, les gouvernements travaillistes de Tony Blair et Gordon Brown ont réalisé d'importantes réformes du marché du travail basées sur l'incitation au travail, tandis que l'Angleterre mettait en œuvre une politique d'immigration opportuniste pour attirer la main-d'œuvre très qualifiée.
Et l'Europe ?
L'hypothèse d'une participation du pays à la zone euro ne semble pas à l'ordre du jour, dans la mesure où la transmission de la politique monétaire unique de la Banque centrale européenne (BCE) en Angleterre pourrait se révéler déstabilisante, dans la mesure aussi où les ménages britanniques sont nettement plus endettés que la moyenne européenne (souvent à taux variables). De plus, il semblerait que l'Angleterre souhaite résolument conserver l'autonomie de sa politique monétaire et s'appuyer sur le dynamisme de son industrie financière, alors qu'elle conserve une attitude critique vis-à-vis de la construction européenne et du niveau encore insuffisant de libéralisation des marchés.
Comme les Etats-Unis, le modèle anglais est un « modèle bipolaire » : services sophistiqués avec un poids énorme de la finance (21 % de l'emploi total contre 4 % en France) et secteurs peu sophistiqués vivant des revenus créés par la finance. Ce modèle n'est pas sans danger puisqu'il rend le pays très vulnérable aux crises financières et immobilières lorsque le marché se retourne : comme aux Etats-Unis les ménages sont alors confrontés à la chute de leur richesse patrimoniale, boursière et immobilière (effet de richesse négatif). Le pays a besoin d'une monnaie forte car il est dépendant des importations étrangères : la dépréciation de la livre sterling depuis l'été 2007 en raison de la crise financière a donc exercé des effets très négatifs sur le pouvoir d'achat des ménages.
Le « modèle bipolaire » s'est aussi accompagné d'une aggravation des inégalités de revenus : les activités financières ont incontestablement dopé les revenus du capital et les hautes rémunérations mais provoqué une hausse des prix de l'immobilier très pénalisante pour les ménages souhaitant accéder à la propriété. Les statistiques britanniques en matière d'emploi, officiellement flatteuses, cachent l'exclusion massive d'une partie de la population (notamment les « invalides »), tandis que le niveau des retraites n'atteint que 40 % en moyenne du revenu perçu auparavant (contre 60 à 70 % dans les autres pays européens). Le pays reste en queue de peloton parmi les pays de l'Union européenne en matière de santé : file d'attente pour certains soins malgré des progrès récents, problème préoccupant du tabagisme et de l'alcoolisme, écart persistant en termes d'espérance de vie entre les travailleurs manuels et non manuels.
Un modèle en crise
Le ralentissement des activités financières en raison de la crise devrait durablement pénaliser l'économie britannique, désormais spécialisée dans ce secteur à hauteur de 15 % de son PIB, alors que l'éclatement de la bulle immobilière devrait freiner la consommation des ménages en raison de la remontée des taux d'intérêt. Les pouvoirs publics seront comme aux Etats-Unis amenés à intervenir massivement (comme l'a fait le gouvernement de Gordon Brown pour sauver une partie du secteur bancaire) : mais le creusement de la dette publique (84 % du PIB en 2010) et des déficits (12,6 % du PIB en 2009) pourrait compromettre gravement l'équilibre des finances publiques, pourtant inscrit comme une règle d'or scrupuleusement suivie jusqu'ici, dans une période de ralentissement de la croissance, où les recettes fiscales se tarissent et les dépenses progressent. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a déjà considérablement abaissé ses taux d'intérêt pour relancer l'économie, et ne dispose plus de grandes marges de manœuvre, tandis que le danger de la déflation guette l'économie britannique.
Les auteurs
Patrick Artus est directeur de la recherche de Natixis, membre du Cercle des économistes, professeur à l'Ecole polytechnique et professeur associé à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Marie-Paule Virard est journaliste indépendante, ancienne rédactrice en chef du magazine Enjeux-Les Echos. Alexis Garatti est économiste et analyste chez Natixis.
Tables des matières
Est-il trop tard pour sauver l'Amérique ?
Introduction. Le nouveau défi américain
I. La fin du « modèle américain »
II. Dans le piège de la dette
III. Le dollar, faible, forcément faible
IV. Le rêve brisé
V. Le défi chinois : « Nous vous haïssons les gars !»
VI. Il faut sauver le soldat Obama
Conclusion. Le difficile pari d'Obama
Pourquoi l'Angleterre a perdu. La faillite d'un modèle économique et social
Introduction : Une rupture du modèle britannique avec la crise ?
I. L'exigence de flexibilité
II. L'ère Thatcher
III. Le modèle Thatcher : une martingale ?
IV. Les risques de la spécialisation productive du Royaume-Uni
V. Les inégalités, conséquences inévitables du modèle
VI. Les enseignements de la crise financière
VII. Un échec révélateur : la santé
VIII. La mort du modèle britannique
Conclusion. Les défauts restent, les avantages s'envolent
Quatrièmes de couverture
L’installation de Barack Obama à la Maison-Blanche coïncide avec une remise en cause sans précédent du « modèle » américain. L’économie d’endettement issue des années 1980 n’a pas résisté au choc de la crise financière et les États-Unis doivent désormais faire face à l’affaiblissement de leur puissance économique, industrielle et financière, à l’étiolement de leur leadership mondial et au doute d’une société fragilisée par le creusement des inégalités.
Dans cet essai vif et documenté, Patrick Artus et Marie-Paule Virard expliquent les causes de ce déclin, ainsi que ses conséquences économiques, financières, voire géopolitiques, pour les États-Unis comme pour l’ensemble du monde. Ils montrent pourquoi, en dépit d’un leadership incontestable dans les nouvelles technologies, leur économie crée moins de richesses et se révèle de plus en plus inégalitaire. D’où la fuite en avant dans l’endettement, facteur clé de la grande crise de 2007-2008. Entre récession et facture du sauvetage du système bancaire, la situation des finances publiques va donc continuer à se dégrader. Et la dette extérieure continuer à augmenter, ce qui rendra les États-Unis toujours plus dépendants de pays prêteurs – avec la Chine au premier rang –, de plus en plus tentés d’affirmer leur supériorité.
Est-il trop tard pour sauver l’Amérique ? Un affrontement États-Unis/Chine est-il inéluctable ? Le pire n’est jamais sûr, mais le défi que doit relever Obama est immense. Il ne concerne pas seulement l’avenir de l’Amérique mais celui du monde entier. L’intérêt majeur de ce livre est de donner au lecteur toutes les clés pour comprendre ces enjeux.
Le Royaume-Uni a longtemps été donné comme exemple : faible taux de chômage, facilité à créer des entreprises, croissance forte et élévation du niveau de vie moyen. Mais qu'en est-il vraiment ?
Certes, l'économie est très flexible : elle n'est freinée ni par une intensité capitalistique trop forte (comme dans les " vieilles industries "), ni par des règles contraignantes (sociales, du marché du travail...). Elle peut à tout instant se reconvertir dans les activités les plus rentables. Elle accepte librement l'immigration, les capitaux étrangers et est donc très différente des économies de la zone euro, plus immobiles, plus capitalistiques, plus fermées vis-à-vis du reste du monde.
Mais les inconvénients de ce modèle sont massifs : la performance du marché du travail est médiocre (quand on tient compte en particulier du chômage déguisé en disabled ), les retraites fondent, le système de santé s'effondre, les inégalités de revenu sont considérables. Les gouvernements travaillistes n'ont modifié qu'à la marge le modèle légué par Margaret Thatcher, et Gordon Brown, le coupable désigné de la faillite anglaise, est en réalité le syndic d'une économie " monoproduit " sinistrée. Voilà comment un modèle unique au monde se trouve aujourd'hui en échec.