L'ouvrage
Dans cet essai, Antoine Frérot, chef d’entreprise, PDG de l’entreprise Veolia, et Rodolphe Durand, enseignant dans une grande école de management, HEC, unissent leur voix pour défendre l’entreprise, injustement vilipendée, et accusée de tous les maux.
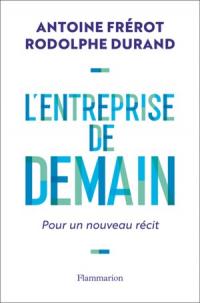
Format PDF
Introduction
À la faveur d’une double vision, celle du praticien et celle du théoricien, et sans nier des comportements parfois irresponsables de certaines entreprises, ils plaident pour que l’on reconsidère le rôle indispensable des entreprises dans nos sociétés, comme lieu de créativité, d’innovation, et d’échange, mais aussi de lien social, comme la période de la pandémie de la COVID-19 l’a démontré en maintenant les circuits de distribution, de production et de consommation au service des Françaises et des Français. Ainsi, « Pour que la population ne manque pas des produits indispensables, des entrepreneurs ont maintenu la production, des collaborateurs ont préservé les livraisons, les approvisionnements ou la montée en charge des réseaux Internet des télécommunications, et c’est grâce à elles que les services essentiels n’ont pas été interrompus, grâce à elles que, malgré l’isolement forcé, les fonctions vitales de tant de pays ont été préservées ».
Mais dans ces pages, Antoine Frérot et Rodolphe Durand militent pour « une entreprise dépourvue des travers du capitalisme trop exclusivement financier, une entreprise plus consciente de son rôle dans la société, une entreprise au service de ses parties prenantes, autrement dit une entreprise plus utile, et je l’espère, plus aimée ». Ils rappellent que pour les citoyens, les entreprises sont un lieu de vie incontournable, à la fois en tant qu’ils sont des consommateurs exigeants en quête de nouveaux biens et services, mais aussi parce qu’ils sont des salariés qui en attendent un statut social, une possibilité d'épanouissement, et une stabilité quant à leur avenir. Pourtant, l'entreprise reste souvent vouée aux gémonies, car réduite à sa fonction de « maximisation » du profit, ou à un lieu d'exploitation et d'oppression par certaines voix critiques. Or l’entreprise est aussi un lieu où les entrepreneurs preneurs de risque innovent. Longtemps d’ailleurs, le terme « entreprise » désignait une opération aventureuse, chevaleresque. Dans l'économie globalisée, et dans un univers plus que jamais schumpétérien, caractérisé par des mutations technologiques rapides et des changements incessants des marchés, où l'avantage concurrentiel s'avère fragile, l’entreprise reste le lieu privilégié d’invention collective et de domestication du progrès technique (dépôts de brevets, savoir-faire, mobilisation des sciences et des techniques). Mais en tant qu'institution, profondément inscrite dans son environnement économique et social, l'entreprise est plus que jamais aujourd’hui soumise, selon Antoine Frérot et Rodolphe Durand, à la nécessité de concilier la production de richesse et la prise en compte des intérêts collectifs des différentes parties prenantes qui la constituent.
Lire une activité pédagogique sur l’entreprise Veolia :
Le succès de la vision de l’entreprise actionnariale
Le point de départ de leur analyse est celui d’un constat : à partir des années 1970, le modèle d’une certaine conception de l’entreprise, fondée sur la toute-puissance de l’actionnaire s’est imposée, nourrie des conceptions des économistes de l’école de Chicago, parmi lesquels son chef de file, Milton Friedman. La vision actionnariale de l’entreprise s’inscrit dans le prolongement d’une approche très libérale de l’économie. Selon l’école de Chicago, l’entreprise appartient aux seuls actionnaires. Son but est dès lors de maximiser les profits, et donc la valeur qui revient à ses propriétaires, les actionnaires. Cette théorie repose sur deux postulats :
- La poursuite de l’intérêt de l’entreprise est égale à la poursuite de l’intérêt des actionnaires ;
- La poursuite de l’intérêt de l’entreprise aboutit à un optimum économique pour l’ensemble d’une économie, qui lui-même permet d’atteindre un optimum social ;
Cette vision s’est propagée car elle a démontré sa simplicité, sa souplesse et son efficacité opérationnelle pour créer des richesses et améliorer le bien-être de toutes les parties prenantes de l’entreprise. Le système de gouvernance « orienté actionnaires » articule donc les mécanismes d'incitation et les mécanismes de sanction pour les dirigeants, afin d'aligner l'intérêt des managers avec celui des actionnaires. Cette grille de lecture unidimensionnelle s’est aussi imposée dans le monde universitaire en raison de sa rationalité et de sa facilité à être exposée. Les firmes sont invitées à se recentrer sur l'objectif de rentabilité et de maximisation de la richesse actionnariale, par une rationalisation de la production, une élévation de la productivité et une diminution des coûts salariaux.
Désormais chaque firme ayant recours aux marchés financiers voit ses performances comparées à toutes les autres par les investisseurs institutionnels : si elle ne présente pas le même niveau de rentabilité pour ses actionnaires que d'autres entreprises présentant un risque équivalent, les actionnaires peuvent se désengager très rapidement du capital et forcer les dirigeants à prendre les mesures nécessaires pour atteindre la norme de rentabilité du secteur. Cette nouvelle gouvernance de l'entreprise s'inspire des standards anglo-saxons et se déploie dans un climat intellectuel marqué par un regain d'intérêt pour les idées libérales, dans un contexte d’effondrement des économies planifiées collectivistes. Dans le cadre de cette corporate governance, le top Management des entreprises se focalise sur des indicateurs financiers comme le ROI (Return on Investment), la création de valeur boursière (shareholder value), l'EVA (economic value added) mesurant la valeur créée pour les actionnaires, ou la valeur de marché (fair value).
Dès lors, « plus rapide, plus efficace, plus pragmatique, (cette vision de l’entreprise) facilite la prise de décision en réduisant la complexité d’une situation à une dimension principale : la rentabilité du capital ».
Pour une vision élargie de l’entreprise
Or si l’on ne peut accabler cette théorie de la valeur actionnariale, qui ne fait que modéliser, sous certaines hypothèses, comme toute théorie, des conséquences observables dans un domaine donné, c’est sa généralisation comme référence qui est plutôt en cause. Car pour Antoine Frérot et Rodolphe Durand, « malgré ses mérites, la vision actionnariale de l’entreprise contient des simplifications réductrices déconnectées de la réalité actuelle ». Parmi lesquelles les conséquences sur l’environnement, l’emploi ou les inégalités de revenu, ou en matière d’impact à long terme (« À quoi bon se préoccuper du long terme et des parties tierces si l’on compte revendre ses actions dans six mois ? »). L’excès d’indignité qui frappe l’entreprise dans certains discours est donc injuste, en ce sens qu’elle se trompe de cible : le « tout financier » a détérioré l’image de l’entreprise, y compris dans l’esprit de brillants étudiants diplômés des écoles de management. Pourtant, Antoine Frérot et Rodolphe Durand en sont convaincus, l’entreprise est bien le lieu qui pourra redonner espoir aux jeunes générations, si elle répond à leurs aspirations, et prend ses distances avec la toute-puissance du modèle actionnarial. Ils rappellent d’ailleurs que l’Institut de l’entreprise a mis tout en œuvre pour instaurer un dialogue fructueux entre les dirigeants des grands groupes et les entrepreneurs sociaux.
« Je veux que l’on réforme profondément la philosophie de ce qu’est l’entreprise » : depuis cette déclaration du Président de la République Emmanuel Macron en 2017, la loi PACTE a « secoué le modèle friedmanien » (de l’entreprise actionnariale) et davantage intégré les enjeux sociaux et environnementaux, justement en leur donnant force de loi, avec la définition de la « raison d’être de l’entreprise ». Les auteurs rappellent que ce texte marquant 0porte sur la gouvernance de l’entreprise et la nécessité de changer son « objet social », afin qu’il soit moins tourné vers la recherche du profit à court terme, en intégrant l’ambition d’améliorer le dialogue social et la prise en compte des parties prenantes, en augmentant le nombre d’administrateurs salariés notamment. Il a également modifié certains articles importants du Code civil pour préciser la « raison d’être » des entreprises, consacrer la notion jurisprudentielle d’« intérêt social », et pour affirmer la nécessité pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité. L’objectif est ici d’inscrire la « raison d’être » de l’entreprise dans un projet davantage soucieux du long terme et de l’intérêt collectif. De plus, la loi Pacte a instauré la qualité de « société à mission » pour les entreprises qui souhaitent expliciter dans leurs statuts, les missions qui découlent de leur raison d’être, et s’engager publiquement à les réaliser vis-à-vis de toutes leurs parties prenantes.
Antoine Frérot et Rodolphe Durand souhaitent d’ailleurs tordre le cou à l’idée que cette « responsabilité sociale de l’entreprise » (expression qu’ils jugent d’ailleurs imprécise), s’accompagnerait d’une moindre performance et d’une compétitivité affaiblie. Malgré la complexité technique d’une telle comparaison, les études disponibles montrent plutôt le contraire, tant en matière de rentabilité du capital, que de satisfaction des salariés et des clients à long terme (« la balance semble donc clairement pencher en faveur de la RSE »). Les auteurs soulignent que dans l’esprit des décideurs, patrons, investisseurs, et dans celui des universitaires, cette idée gagne du terrain : « le débat est ouvert, et au plus haut niveau de décision économique, sur ce qui établit les normes de fonctionnement du capitalisme ». Tout l’enjeu est d’être inventif en matière de gouvernance pour concilier la réponse aux enjeux environnements et sociétaux et la rentabilité légitime du capital investi. L’entreprise, en tant que communauté humaine, est intégrée et fondamentalement collaborative, constituée d’unités interdépendantes : la crise sanitaire a rappelé que l’entreprise se définit avant tout par son projet, par les femmes et les hommes qui la composent : « c’est cette humanité qui seule confère à l’entreprise la souplesse nécessaire pour résister pour résister aux crises ». C’est dans cet esprit « d’entreprise commune » que les équipes de Veolia ont déployé de nombreuses actions pendant la crise sanitaire, notamment en ouvrant le campus de Lyon aux personnes sans abri.
Lire le cours de spécialité SES en première sur le thème de l’entreprise :
Un troisième récit ?
Antoine Frérot et Rodolphe Durand rappellent que la gouvernance de l’entreprise se différencie du gouvernement stricto sensu, qui suppose une organisation centralisée et hiérarchisée du pouvoir : abstraction faite d’éventuels rapports hiérarchiques, celle-ci suppose une coopération de plusieurs « parties prenantes », déterminées à partager un objectif commun (que l’on appelle affectio societatis), en dépit de divergences d’intérêts qui peuvent entraîner des oppositions. On distingue généralement deux grands modèles de gouvernance de l’entreprise :
- Dans l’optique « stakeholders », l’entreprise est considérée comme une organisation composée de différentes « parties prenantes » (appelées communément « stakeholders »), incorporant les actionnaires, les salariés, les fournisseurs de l’entreprise, ses clients... Chacun de ces groupes a des intérêts qui lui sont propres et qui peuvent être opposés à ceux des autres. C’est la gouvernance « managériale » ou « partenariale ».
- Dans l’optique « shareholders », le gouvernement d’entreprise correspond à l’ensemble des moyens mis en œuvre pour s’assurer que les décisions de l’entreprise, la gestion de ses actifs et le comportement de ses dirigeants et de ses salariés vont bien dans le sens des objectifs tels qu’ils ont été définis par les actionnaires et eux seuls. Le modèle « shareholder » ne diminue pas l’importance qu’ont les autres parties prenantes, mais distingue clairement l’objectif (la maximisation de la rémunération des actionnaires) et les moyens pour atteindre cet objectif (la satisfaction des intérêts des autres « parties prenantes » de l’entreprise). C’est la gouvernance « actionnariale » de type friedmanien.
Or face aux défis du XXIème siècle (changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, inégalités de développement), une troisième voie est possible selon les auteurs : « il ne faut pas moins d’entreprise, non il en faut plus ». Il faut inlassablement prouver l’utilité de l’entreprise, et pour cela Antoine Frérot et Rodolphe Durand évoquent plusieurs pistes :
- Ajuster les demandes de l’actionnaire : la gouvernance de l’entreprise ne peut naturellement pas se tourner contre les actionnaires (apporteurs de capitaux indispensables), mais il s’agit d’équilibrer la part de finance impatiente (centrée sur la rentabilité à très court terme) et patiente, notamment en accroissant l’actionnariat salarié afin d’impliquer les apporteurs de capitaux dans un projet à long terme ;
- Impliquer les salariés dans les décisions : il s’agit de répondre aux besoins des équipes des collaborateurs de l’entreprise qui sont les forces vives de son projet ;
- Responsabiliser le client : il s’agit pour l’entreprise de faire comprendre aux clients, véritable partie prenante, qu’ils sont un maillon fondamental de la transformation de l’entreprise dans un sens conforme à la responsabilité sociale et environnementale ;
Enfin, Antoine Frérot et Rodolphe Durand insistent dans cet essai sur le principe de solidarité : « les entreprises peuvent difficilement réussir dans une société qui échoue et, en tout état de cause, ne pourront pas prospérer longtemps dans une société qui décline ». Si l’entreprise peut mener légitimement des actions philanthropiques, elle doit surtout réfléchir à sa raison d’être dans une société exigeante qui lui demande de davantage intégrer dans son tableau de bord les externalités qu’elle génère. Cela ne pourra se faire que si la mesure de la performance de l’entreprise devient fondamentalement multicritère. Ce troisième récit que Antoine Frérot et Rodolphe Durand appellent de leurs vœux est alors « un récit de progrès, articulant harmonieusement activité économique, développement du bien-être et protection des milieux naturels ».
Lire la note de lecture sur le livre de Blanche Segrestin et Armand Hatchuel « Refonder l’entreprise » (Seuil) :
Quatrième de couverture
Court-termiste, polluante, rivée à ses seuls intérêts... Depuis une vingtaine d'années, un feu nourri de critiques s'abat sur l'entreprise, contestant sa légitimité. Naguère fierté nationale et dépositaire du progrès, elle se voit aujourd'hui chargée d'opprobre pour avoir contribué aux maux qui affligent la planète, du creusement des inégalités à la crise écologique. Les auteurs de ce livre en ont pourtant la conviction, l'entreprise est un bienfait. Que certains de ses acteurs l'aient un temps oublié ne fait que souligner l'urgence de la ramener à sa vraie raison d'être : son utilité pour la société. Et, à ce titre, elle a son rôle à jouer dans les défis colossaux qui marquent notre époque. Une telle ambition ne pourra aboutir sans une redéfinition collective du capitalisme. S'appuyant sur les leçons enseignées par les récentes crises et sur le regard croisé d'un grand patron et d'un professeur chercheur, L'Entreprise de demain veut poser les fondations de ce nouveau récit.
Les auteurs
Antoine Frérot : Polytechnicien et ingénieur des Ponts et chaussées, est P-D.G de Veolia depuis 2009.
Rodolphe Durand : est professeur à HEC


